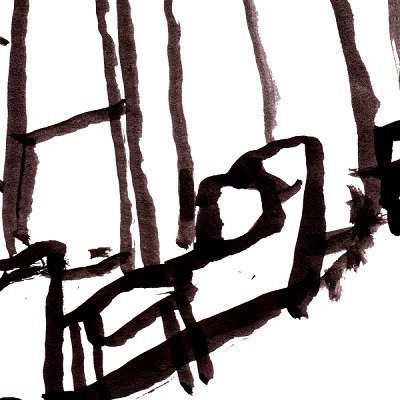Liberté et consentement

Auteur : Emeline Deroo, philosophe et animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : Alors qu’on associe souvent la liberté au fait d’agir, de décider ou d’exprimer sa volonté, on peut se demander si la liberté n’a pas également un lien avec le fait d’assumer l’impuissance, d’accepter la nécessité plutôt que de s’insurger contre elle. Est-on libre quand on lâche prise ?
Temps de lecture : 10 minutes
Liberté et consentement : un acte profondément libérateur ?
Si la liberté consiste à choisir, décider ou agir indépendamment des circonstances matérielles, sociales ou idéologiques, ne doit-on pas alors supposer qu’elle repose en ultime instance sur un acte de la volonté ?
Cette articulation entre liberté et volonté peut nous emmener loin. Par exemple, comment qualifier ces moments où nous lâchons prise, où nous acceptons un état de fait, où nous cessons de lutter et choisissons plutôt d’acquiescer ? Accepter l’impuissance, est-ce encore un acte libre ?
Oui, selon Paul Ricoeur[1] ! C’est même dans cet acte que culmine la volonté libre. Alors que la liberté est trop souvent réduite à la capacité à dire NON, scandée comme un cri de refus, un « non » adressé vigoureusement à toutes les formes d’injustice, d’inégalité, il importe de se demander si consentir, dire « oui » à la nécessité, ne s’inscrit pas tout autant dans le champ de la liberté. Mais acquiescer à la nécessité des choses ne serait-il pas une manière polie de céder au fatalisme ? Non : pour Paul Ricoeur, consentir n’est ni se résigner, ni se soumettre ou capituler, mais une « active adoption de la nécessité »[2]. Il s’agit d’une manière de s’approprier, d’assumer, de faire sien un fait : en « voulant le pur fait, je le change pour moi à défaut de le changer en soi ». C’est en ce sens que peuvent coïncider consentement et volonté libre : « le consentement est la marche asymptotique de la liberté vers la nécessité ». Mais de quelle liberté parle-t-on ici ? Si le lecteur reste perplexe, qu’il daigne tirer avec nous le fil de cette idée originale qui nous embarque une fois de plus sur le terrain du paradoxe.
Dans l’ouvrage consacré au volontaire et à l’involontaire[3], Ricoeur s’attache d’abord à analyser l’acte de volonté. Il décompose celle-ci en trois « moments » ou plutôt, trois points de vue : 1) la décision, c’est-à-dire l’acte de la volonté qui s’appuie sur des motifs, des choix, des valeurs ; 2) l’agir, c’est-à-dire la volonté qui se met en mouvement, ébranle des pouvoirs, produit un effort ; 3) le consentement qui est l’acte de la volonté qui acquiesce à la nécessité. Décider, agir et consentir sont ainsi trois composants de la volonté. C’est le dernier élément, le consentement, qui doit nous intéresser ici car il synthétise un trait paradoxal de la liberté humaine et produit un décalage avec l’idée que nous nous en faisons communément. Ce paradoxe se résume comme suit : accepter notre impuissance, renoncer à l’idée d’une souveraineté de la volonté est en soi un acte de libération. Ce dont le consentement libère, c’est de l’illusion d’une conscience comme absolu, comme purement productrice de soi. Sous cet angle, la liberté apparaît profondément paradoxale : elle n’est pas l’acte pur d’une volonté agissante, car la volonté elle-même relève d’un processus qui culmine dans l’adoption de la nécessité. La liberté serait alors donc autant activité que réceptivité, capable de se manifester autant dans le refus que dans l’acceptation. Que s’agit-il d’accepter au juste ? Nos limites. Ricoeur appelle cela l’involontaire absolu.
Pour mieux comprendre ce que recouvre la nécessité, appuyons-nous sur ce que Ricoeur définit comme l’involontaire de la condition humaine. L’involontaire se compose de trois choses : le caractère, l’inconscient et la vie.
- Le caractère : en raison de son histoire et de ses appartenances, toute homme porte des valeurs. Toute conscience a un style et un point de vue singulier sur le monde. L’homme évolue au cours de sa vie et, même s’il change, il conserve un caractère, une façon d’être dans le monde.
- L’inconscient recouvre tout ce qui nous échappe dans nos actes et nos choix, c’est la raison voilée de nos motifs. En réalité, il n’est d’ailleurs pas lui-même « motif mais source de motifs »[4]. En ce sens, toute décision « n’est jamais qu’un îlot de clarté sur une mer obscure et mouvante de virtualités inconscientes »[5].
- La vie est l’arrière-plan général qui fait que « quelque chose » peut avoir lieu[6], qu’une valeur puisse être affirmée, qu’un effort puisse être accompli. Les états de la vie ont un impact décisif sur la volonté : être fatigué ou malade, avoir été un enfant avant d’être un adulte sont autant de facteurs qui colorent notre volonté.
Nier ce triple visage de l’involontaire, c’est ressusciter la démesure prométhéenne au mépris de la contingence de notre existence, c’est-à-dire de tout ce que nous ne choisissons ni ne pouvons choisir dans notre vie. Le désir d’une vie pleine de sens ne suppose pas de tout contrôler. L’anthropologue Tim Ingold abonde dans cette voie : « Donner un sens à sa vie ne veut pas forcément dire en avoir les commandes. En effet, présumer maîtriser une situation d’incertitude existentielle, c’est aller au désastre. Les plans les mieux conçus peuvent se trouver bouleversés si l’on échoue à répondre aux exigences d’une situation »[7]. Dans ce dernier cas, la liberté ne relèverait pas véritablement de la subordination d’une situation à des objectifs par une volonté souveraine. Au contraire, elle se forge par celui qui se montre capable de répondre adéquatement à ce que demande une situation en particulier. En d’autres termes, être libre consiste moins à dominer un état de faits qu’à être capable d’improviser face à l’imprévu et ce qui ne nous est pas familier. Cela requiert deux facultés, l’attention et la présence : être attentif à ce que nous présente une situation exige d’y être pleinement présent.
Ces thèmes de la présence et de l’attention nous acheminent vers l’idée que le consentement n’appartient pas au registre de l’effort, c’est-à-dire du « faire » mais, au contraire, renvoie à une forme d’impuissance assumée comme telle. Plus précisément, le consentement « convertit son impuissance en une nouvelle grandeur ; quand je transforme toute nécessité en ma liberté, alors ce qui me borne et parfois me brise devient le principe d’une efficacité toute nouvelle, d’une efficacité entièrement désarmée et dénuée »[8].
Quand on est en proie à une souffrance psychique, la question du consentement peut embarrasser. Ce terme renvoie usuellement à l’absence de liberté que peut ressentir une personne qui souffre. Dans ce cas, le consentement se couple presque toujours à l’incapacité de pouvoir choisir : suivre ou non un traitement, laisser ou non les symptômes s’exprimer, choisir un lieu de vie, être hospitalisé ou pas, travailler pour se rétablir ou se rétablir pour travailler, etc. Dans toutes ces situations, le consentement résonne comme une dépossession de ses choix et de sa liberté, soit parce que l’on n’est momentanément pas capable de décider pour soi-même, soit parce que l’on juge en être incapable. Le consentement dont nous déployons ici les lignes de force ne se situe pas sur un plan juridique ou politique, mais bien existentiel. Si nous oublions cette distinction, la nécessité prend alors une allure démagogique qui contraindrait ceux qui n’ont pas les ressources pour lutter à se résigner à une situation potentiellement très injuste. L’enjeu, précisément, est de situer cette zone de notre existence où le consentement devient outil de libération et non d’aliénation.
Ricoeur prendrait ainsi le contre-pied d’une approche « défaitiste » du consentement. Ce dernier ne s’apparente ni à un aveu de faiblesse, ni à une soumission induite par l’absence de choix, mais invite plutôt à s’alléger les épaules. Au nom de quoi devrions-nous prendre ce recul ? Nous sommes bien souvent acteurs de notre propre aliénation justement parce que nous luttons et dépensons toute notre énergie contre des faits contre lesquels nous ne pouvons rien et dont généralement nous ignorons d’ailleurs les causes[9]. Or, la nécessité, contrairement à ce que l’on croit, n’est pas toujours l’ennemie de la liberté. Une liberté qui demeure dans le refus en rejetant le consentement demeure une liberté bougonne qui n’assume pas son inachèvement et son caractère paradoxal. Or, l’homme gagnerait beaucoup à reconnaître que sa liberté n’est pas toute-puissante, mais que sa grandeur est à la mesure de son ouverture à l’inconnu, à ce qui est hors de notre contrôle, à ce qui nous rend fragile et à quoi nous devons prêter toute notre attention [10].
Références
[1] Paul Ricoeur (1913-2005) est un philosophe français. Il a contribué au développement du courant phénoménologique en France, mais il est aussi un grand penseur de l’éthique. Il inspire beaucoup les cliniciens et les intervenants, notamment à travers les enjeux gravitant autour du récit de soi.
[2] RICOEUR, Philosophie de la Volonté, Le volontaire et l’involontaire (tome 1), Aubier, Paris, 1949, p. 322.
[3] La thèse de Ricoeur, publiée sous le titre Philosophie de la volonté, est composée de trois tomes. Le premier tome, Le volontaire et l’involontaire (publié en 1949) qui s’achève avec sa réflexion sur le consentement, est le fruit d’un travail mûri dans un camp d’officiers où il a été fait prisonnier en 1940, et dont la rédaction s’est terminée après la guerre.
[4] Ibid., p. 320.
[5] Idem.
[6] Tenir compte du fait que l’homme est un être vivant peut sembler d’une évidence déconcertante, or les philosophes ont parfois tendance à oublier que le sujet qu’ils analysent n’est pas qu’une conscience dans l’absolu, mais qu’il a une histoire et un corps.
[7] INGOLD Tim, L’anthropologie comme éducation, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 37.
[8] RICOEUR, Ibid., p. 323.
[9] C’est le philosophe Baruch Spinoza qui a thématisé cette idée : « Les hommes se croient libres par cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions, mais qu’ils ignorent les causes qui les déterminent » (SPINOZA, L’Ethique, III, proposition 2, scolie).
[10] L’idée de consentement trouve un certain écho dans une pensée contemporaine qui s’inspire d’ailleurs de Spinoza et du zen : c’est celle d’abandon prônée par l’écrivain Alexandre Jollien (voir notamment Petit traité de l’abandon). A nouveau, loin d’une pensée résignée, il s’agit d’offrir un accueil à ce que nous ne maîtrisons pas. Cette attitude rappelle un peu la prière de la sérénité (qui invite chacun à avoir la sérénité d’accepter ce qu’il ne peut pas changer, le courage de changer ce qu’il peut et la sagesse d’en connaître la différence). Cette prière a notamment été rendue célèbre par le mouvement des Alcooliques Anonymes qui en a fait un pilier dans le processus de rétablissement.