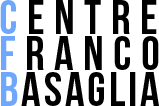Le partage serait l’affaire principale de la psychiatrie

Auteur : Olivier Croufer, animateur au Centre Franco Basaglia
Résumé : Et si l’affaire psychiatrique-santé mentale était principalement une affaire de partage ? Cette hypothèse a été formulée dans un réseau dense d’associations et d’expériences locales qui mettent au travail nos rapports aux troubles psychiques et psychiatriques. Elle est arrivée au milieu d’une séquence, une durée vivante au cours de laquelle nous cherchons à composer autrement avec nos modes d’être au monde.
Temps de lecture : 15 minutes
La psychiatrie et la santé mentale nous mettent en partage. Nous pourrions aussi l’écrire sous la forme d’une hypothèse : et si l’affaire psychiatrique-santé mentale était principalement une affaire de partage ?
Drôle d’interrogation, très ramassée, vrillée, avec un « et si… » pour commencer la question, comme s’il y avait soudain dans cette forêt dense de l’affaire psychiatrique-santé mentale des voies plus lumineuses, principales même, pour s’orienter à nouveau : le partage.
En tout cas, nous avons pris cette question au sérieux. Le mieux est de commencer par préciser ce « nous » : qui a formulé cette question, comment elle est arrivée.
Nous sommes situés dans un réseau dense d’associations et d’expériences locales (une ville de 200 000 habitants)[1]. Un biais est de présenter ce réseau par les personnes qui l’enchevêtrent et par une bribe plus fragmentaire encore, les titres dont elles s’affublent. Nous rencontrons dans ce réseau des ouvriers du bâtiment, des psychologues, des artistes plasticiennes, une romaniste, des cuisiniers, des gestionnaires administratifs, des secrétaires, des éducateurs, une philosophe, un chargé de communication, un psychiatre, des graphistes, des animateurs culturels, des assistants sociaux, des comptables. Ceci pour le versant employé.e.s de ces associations. Du côté des bénéficiaires désignés, nous rencontrons autant une ouvrière du bâtiment qu’un homme au foyer, un serveur de café qu’une voleuse. Ici, la désignation par les titres d’emploi, même potentiel, est plutôt chancelante, ces titres sont souvent suspendus ou vidés d’une accroche. Souvent ils, elles ne viennent pas sous la bannière d’un métier, mais au départ d’un intime problématique que notre époque, nos institutions désignent comme « trouble psychique », « trouble psychiatrique », « problème de santé mentale ».
L’énonciation partielle de ce « nous » suffit, pour l’instant. Plus tard, on aura besoin d’élargir le mouvement de ces figures parmi les occupants de la forêt. Pour l’instant, ça suffit car il s’agit simplement de comprendre que la formulation de cette hypothèse – et si l’affaire psychiatrique-santé mentale était principalement une affaire de partage – provient de rencontres éparses dans des expériences collectives soucieuses de nos rapports aux troubles-problèmes-psychiques-psychiatriques-santé mentale. Ces rencontres éparses ont servi de sentinelles et d’accroches partielles à la formulation progressive de cette question. S’il y a bien « affaire », c’est que l’enchevêtrement de ce qui a été entendu, incompris, vu et digéré est effectivement un entrelac de préoccupations de natures très diverses, tellement diverses que l’agencement des modalités de préoccupations réciproques ne va jamais de soi.
Toutes ces personnes dans ces différentes expériences sont attachées – différemment – à cette affaire, nous aurions d’ailleurs aussi pu écrire attachées à cet à-faire, car elles sont impliquées dans des agirs, elles cuisinent ensemble, elles font du graphisme, elles parlent, elles font des courses au magasin, elles font des plans d’avenir, elles créent des circonstances pour s’exprimer. Mais toutes ces personnes sont aussi disjointes. Elles ne sont pas toutes-toutes ensemble, ni toutes en même temps, ni avec les mêmes personnes, ni dans les mêmes agirs, ni dans les mêmes genres de sensibilité à l’autre. À cet endroit, a jailli l’affaire du « partage ». Nous sommes divisés. Nous divisons. Nous nous partageons. Où passe la coupure qui partage est difficile à dire. Il existe des coupures manifestes, visibles. Nous occupons le territoire à des lieux différents. Les espaces, les bâtiments sont dans différents endroits. De ces différents espaces, nous occupons le territoire différemment, les relations avec les occupants du territoire sont différentes, les uns vendent des textiles sérigraphiés, les autres organisent un collectif de radiodiffusion, d’autres soutiennent des interrelations médicales.
D’autres coupures sont évidemment plus difficiles à nommer. Elles sont plus difficiles à se dire. On les sent. D’emblée leur formulation n’est pas commune. C’est pour cela qu’elles sont intéressantes dans un ensemble : elles travaillent des écarts minoritaires. Pas tellement des écarts portés par quelques personnes seulement, mais plutôt des écarts qui, parce qu’ils ne sont pas portés par le langage le plus commun, par la pensée la plus commune, les sensibilités les plus communes, ont difficile à se dire, à se penser, à s’exprimer. Se mettre du côté de ces écarts minoritaires revient à se relier à une différence, à des différences qui – peut-être – méritent d’être pensées et vécues dans un ensemble.
Nous sommes ainsi arrivés à prendre le partage comme un double geste. Comment nous pourrions continuer à travailler (écouter, penser, formuler, envisager) des écarts qui nous partagent, de façon à continuer à partager ensemble des modalités différentes d’être en relation avec les occupants de territoires que nous partageons ou que nous sommes en passe de partager. Dit encore autrement : comment nous pourrions penser, agir, vivre en étant sensible à des lignes de différence, de divergence, d’écartement pour faire valoir ensemble ces différences dans les modalités d’être au monde des habitants.
Nous avons formulé trois partages. Ce « nous » reste le même, ce nous situé « dans un réseau dense d’associations et d’expériences locales ». Mais à partir du moment où nous écrivons et nous publions, nous laissons une place – virtuelle – pour que d’autres soient là aussi. Nous tentons de formuler ce « partage » de façon qu’il vienne interroger à différents endroits du social, là où sont des lectrices, des lecteurs. Ainsi, nous avons écrit trois partages.
1. Partage de l’intime
Là où nous sommes, singulièrement dans notre travail, mais pas seulement, nous faisons l’expérience d’un partage de l’intime. L’intime est partagé entre ce qui est donné à l’institution psychiatrique et de santé mentale (donné, confié, travaillé, réfléchi, expérimenté…), et l’intime partageable avec celles et ceux de sa vie quotidienne, parents, ami.e.s[2], voisin.e.s, collègues. Cette coupure – régulièrement perçue comme bénéfique – amène à désigner tel intime comme un problème de santé mentale et le déléguer à des institutions spécifiques. Les ressorts de ce partage où l’intime bifurque vers les institutions de santé mentale sont flous et discutables, assez difficiles à nommer et à penser, mais à l’évidence ce partage est actuellement très opérant. Une foule croissante de souffrances existentielles est renvoyée vers les institutions de la santé mentale. L’emprise désormais dominante de cette délégation[3] vient abasourdir les autres partages, vers d’autres référents culturels qui permettent de comprendre et d’expérimenter ce qui m’arrive, ce qui nous arrive quand nous sommes traversés d’un trouble psychique. Un trouble de l’âme abandonnée de Dieu ? Une violence de genre ? Des conditions d’existences pliées d’injustices sociales ? Une insouciance climatique ? Un amour culturel de la liberté solitaire ? Un dédain pour l’égalité ? Qui sait… La dominance contemporaine de l’horizon de santé mentale[4], sa façon de se saisir de l’intime, affaiblit la multiplicité des incertitudes, des discours, des gestes et des luttes qui pourraient s’inaugurer à l’occasion de la rencontre avec les souffrances existentielles[5]. Si nous nous plaçons à l’horizon d’une démocratie culturelle[6], c’est-à-dire d’un partage plus généreux des référents culturels qui nous permettent d’être ensemble, il y a sans doute à s’attacher aux voix et aux lieux[7] qui appellent l’intime dans des dehors de la santé mentale.
2. Partage de la violence
À l’évidence, les institutions psychiatriques et de santé mentale sont aussi porteuses d’une violence, souvent exercée au nom du soin. Pourtant cette violence est difficile à dire, c’est-à-dire à partager avec les autres. Notamment car nous ne nous accordons pas sur les lignes de partage qui délimitent violence et non-violence, ou les limites au-delà desquelles une violence devient insoutenable. Il en va ainsi des catégories diagnostiques, de la contention[8], des placements de force[9], des exclusions de service, des mots d’ordre…[10] Un flou persiste sur ces lignes de partage de la violence et ce flottant nous met en tension, à vif, car nous voilà percuté.e.s dans nos conceptions les plus ancrées de la dignité. Un même geste, une même pratique peuvent être dits comme rétablissant ou, au contraire, dégradant la dignité. Les institutions de la psychiatrie et de la santé mentale deviennent ainsi l’occasion, souvent manquée, régulièrement ratée, mais en tout cas à saisir, d’un partage des différends de violence[11], et du même coup des conditions qui renouvelleraient des possibilités de dignité et d’hospitalité.
3. Communautés partagées
Une façon de désigner l’extérieur de l’institution psychiatrique et de santé mentale où des processus de démocratie culturelle peuvent s’exercer à l’endroit du trouble psychique est de se rapporter à des « communautés » ou des « collectifs ». Or ceux-ci en voulant inclure le trouble psychique sont souvent menacés d’une reprise, voire d’une duplication, des codes de la santé mentale en confirmant des normes et des identités (pathologiques, notamment) dont ils cherchaient pourtant des émancipations. Souvent, il y a de la mixtion dans ces collectifs, même ceux qui désignent le commun qui les rassemble à partir d’un trouble pathologique, carrément une maladie, car toujours ces collectifs viennent composer avec quelque autre intérêt, un droit, de l’hospitalité, le partage d’une passion[12], d’une distraction qui viennent introduire des sortes d’écarts. Le mixte devient une attention. Le mixte devient un horizon compliqué vers des communautés d’attachements suffisamment hétérogènes[13], bigarrés et disparates qui tiendraient ensemble notamment grâce au souci de ne pas évincer la divergence problématique qu’introduit le trouble psychique.
Ceci nous situe au milieu d’une séquence entamée depuis des mois. Cela nous situe dans une durée. C’est-à-dire un temps qui reste vivant, car il reste ouvert à ce qui arrive par-ci par-là, du passé, de sa présence actuelle au monde. Un temps qui cherche une consistance vécue à cet épars. Au départ, nous ne savions pas trop, désormais la séquence à un titre : En partage. Le titrage stabilise ce qui a pu se glaner à différents endroits. Nous aurions pu tout autant dire que le titrage dynamise ce qui était épars en rattachant des aspects, des occupants d’un territoire, des points de vue. Le titrage vient repriser. Le mot (en partage) raccommode des morceaux flottants, il participe à l’expérience vécue d’une durée. Il révèle, provisoirement, un assemblage partiel de quelques composantes de nos territoires existentiels. Il n’est pas inutile de les dire, ou du moins d’en dire quelques-unes. Le présent de cette durée est toujours à revivre, et comme nous ne sommes pas dans un exercice solitaire, mais à plusieurs, il est sans cesse à reformuler, à redire pour tenter de le vivre ensemble. Les composantes de ces territoires existentiels peuvent être matérielles (les bâtiments et espaces de nos expériences, les objets, les repas, les œuvres qu’on y fabrique, les photos qu’on réalise, les corps dont on se préoccupe) ; ces composantes peuvent être immatérielles (les langues et les mots d’un salon : « tendresse », « point de chute », des théories politiques sur le capitalisme thérapeutique, des élaborations de points de vue sur les strates temporelles de la psychiatrie) ; ces composantes de nos territoires existentiels peuvent encore être d’une autre sorte, des composantes d’agencement (des gestes d’attachements plus ou moins violents, des manières d’être en amitié, des arpentages photographiques, des affects de colère ou d’épuisement, de l’énergie mise à se rencontrer). On donne ces composantes juste pour permettre quelque intuition de ce dont il s’agit pour soi, pour nous, et se mettre dans une séquence, dans la durée d’un travail commun.
C’est parce que nous avons été attentifs à cet épars, à ces composantes hétérogènes, qu’alors une modulation vivante de nos rapports aux troubles psychiques est possible. Peut-être pas encore « possible », pas encore dessinée, mais qu’on puisse au moins sentir que, virtuellement, il y aurait quelque chose à dire, à faire vivre autrement. Pour nous y mettre au travail collectivement, encore faut-il se donner une méthode de tramage, d’assemblage qui nous rassemble. Nous nous laissons infiltrer par des univers d’inspiration, des élans spirituels et des aspirations sociales qui pourraient réunir, allier, mobiliser, ameuter ce divers. Tout en restant bien présents à ce divers pour que ces inspirations ne tombent pas dessus comme un plaquage, un surplomb cimentaire. Ce serait quoi l’affaire d’hospitalité dans l’affaire psychiatrique-santé mentale telle qu’elle s’exprime dans ces composantes de nos expériences ? Ce quoi l’affaire d’une émancipation ? Puis arrive pour ceux qui y travaillent collectivement une ébauche de formalisation, des mots sur un assemblage inspirant, des formulations vrillées sous le jour d’une à-faire sociale d’hospitalité, d’émancipation, de relance à égalité. C’est devenu En partage… et trois formulations différentes pour poursuivre le travail : partage de l’intimité, partage de la violence, communauté en partage.
C’est aussi pour cela qu’on écrit : pour occuper par la parole le temps d’une présence au monde. Maintenant que la séquence s’est donné un titrage et des formulations[14], nous sommes amenés à occuper peut-être un peu différemment nos territoires existentiels. À la suite, il y a certainement quelque chose à produire, subjectivement, en soi, dans ses rapports aux autres, et collectivement, dans les structurations qui permettent de faire vivre nos existences ensemble. Dans une séquence, nous désignons trois modalités de production : des laboratoires, des savoirs, des auditoires. Ceux-ci ne commencent pas maintenant, ils ont déjà fourni les éléments constructeurs de là où nous en sommes. Mais présentement, le point crucial est de mieux formuler avec des interlocuteurs, des interlocutrices ce qui pourrait se dire, se vivre et se formaliser – se produire -.
C’est aussi pour cela qu’on écrit : partir en recherche d’interlocutrices et d’interlocuteurs.
Notes
[1] Le plus quotidiennement, les Expériences du Cheval bleu, quatre ASBL œuvrant dans nos rapports aux troubles psychiques ou psychiatriques (chevalbleu.be), ainsi que quelques autres associations de même acabit.
[2] Sur les possibilités d’un partage dans l’amitié, voir Croufer Olivier, Amitiés (je travaille à une psychiatrie populaire), Centre Franco Basaglia, 2024.
[3] Sur cette dominance contemporaine, voir Croufer, O., Mercier, C., Vanderhaeghen, J., Se faire ses histoires dans l’histoire longue de la psychiatrie, Centre Franco Basaglia, 2024, Strate 3. 1990 à aujourd’hui. Ce qu’on appelle santé mentale. Téléchargeable sur psychiatries.be
[4] Sur ce sujet, on peut lire le petit ouvrage de Bellahssen, Mathieu, La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle, La fabrique, 2014.
[5] Par exemple, en multipliant les narrations de la relation à un parent désigné « bipolaire », tel qu’introduit par Mercier, Clémence, Plutôt qu’un récit de soi, s’attacher à une multiplicité de narrations, Centre Franco Basaglia, 2024.
[6] Nous avions écrit à plusieurs des horizons où existeraient en proportions variables de la démocratie culturelle et de la santé mentale. Dans Croufer O. (et al.), Décroissance et démocratie culturelle, Centre Franco Basaglia, 2019, on retrouve outre l’horizon, de brèves définitions et une bibliographie pour découvrir la « démocratie culturelle ».
[7] Voir le Le livre dont nous sommes les échos issu du labo de l’Autre « lieu » réalisé à la suite « d’une longue exploration collective sur les manières d’accueillir et d’accompagner celles et ceux d’entre nous qui traversent de grandes périodes de troubles » Disponible via le site autrelieu.be.
Voir aussi Un salon dans la ville, un salon dans le café ouvert, Demain jamais (revers.be) qui chaque mois permet aux habitants de partager leurs rapports aux souffrances existentielles telles qu’elles sont amenées par un.e invité.e. Quelques informations sur Un salon dans la ville sur psychiatries.be
[8] Voir Mercier, Clémence, Penser une politique des attachements : une révolution des liens contre une culture des sangles, Centre Franco Basaglia, 2024.
[9] Sur la dimension carcérale, voir le numéro de La Brèche : Psychiatrie et carcéral. L’enfermement du soin, La Brèche, n°5, Printemps 2023, Editions Météores, Bruxelles.
[10] Pour un récit expérientiel actuel de toutes ces violences, Treize, Charge. J’ouvre le huis clos psychiatrique, La Découverte, 2023.
[11] Franz Fanon complexifie ce différend en le mixant aux violences coloniales. Pour une entrée située dans un terrain foot, voir Mercier, Clémence, Equipement collectif – un terrain de foot dans un hôpital psychiatrique, un terrain de foot sur un sol colonisé, Centre Franco Basaglia, 2024.
[12] Le foot, par exemple, dans Mercier, Clémence, Comment le foot nous attache à une institution de santé mentale ? Centre Franco Basaglia, 2024. Ou la photographie dans des arpentages dans la ville (voir psychiatries.be)
[13] Dans le café ouvert, Demain Jamais, nous avions invité Josep Rafanell i Orra pour un dialogue. Dans En finir avec le capitalisme thérapeutique. Soin, politique et communauté, Météore, 2022, il parle des communautés hétérogènes.
[14] La méthode de construction d’une séquence a été déployée dans Croufer, O. (et al.), De la grappe au vin, expérimentation d’une méthode collective d’émancipation, Centre Franco Basaglia, 2023. On y retrouve une exposition formelle (chapitre « technostructure ») et expérientielle (chapitres « séquence, étape I-IV) des notions de séquence, durée, territoire existentiel, univers d’inspiration, laboratoire, savoir, auditoire.