Le ciel était aussi en loques qu’un pyjama de bohémien…

Auteur : Christian Legrève, animateur au Centre Franco Basaglia
Résumé : Y a des livres qui te sautent dessus ! « Même les cowgirls ont du vague à l’âme » de Tom Robbins raconte l’histoire folle de Sissy Hankshaw, qui naît à Richmond, Virginie, avec des pouces d’une taille démesurée. Cette difformité va faire d’elle un être d’exception, avec une trajectoire on ne peut plus singulière. Des personnages singuliers, elle va en rencontrer beaucoup d’autres, dans une Amérique dont la civilisation chancelle. Tout ça dans un récit étourdissant écrit dans une langue flamboyante, pleine d’imagination. L’avis d’un libraire : « Bienvenue chez Tom Robbins, qui orchestre là LE roman subversif de la contre-culture américaine ! Chef d’oeuvre! »
Temps de lecture : 10-15 minutes
Qu’est-ce que la civilisation ? Qu’est-ce qu’être civilisé ? C’est quoi une personne civilisée ? Une nation, un pays, une communauté civilisée ? Qu’est-ce qui fait civilisation ? Quelle place, dans une civilisation, pour ce qui gêne, gratte, dépasse, dérange ? Pour ce qui n’est pas civilisé ? Peut-on, faut-il, pour affirmer et défendre ce qui fait les valeurs d’une civilisation, éradiquer, au besoin par la force, les éléments qui ne correspondent pas au canon (hum !) ?
Voilà, à mon avis, les questions centrales que pose la folle histoire « Même les cow-girls ont du vague à l’âme »[1]. Et aussi, que nous enseignent les migrations des grues cendrées ?
Je dis à mon avis, parce que Tom Robbins se laisse emporter par son récit, multiplie les pistes, les personnages, les intrigues secondaires. Il enchaîne les questionnements, il nous trimballe et digresse allègrement. Sans jamais lâcher son sujet, pourtant.
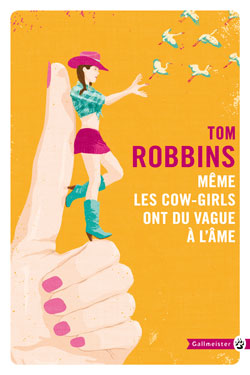 Even cow-girls get the blues… Quel titre formidable ! Plein de promesses… Sissy Hankshaw a été dotée à sa naissance des deux plus longs pouces du monde ! Ses pouces, elle les vit comme une part d’elle-même qu’elle ne comprend pas, qui la dépasse et qui l’entraîne. Dans une première période de sa vie de jeune adulte, elle accueille ça comme un cadeau. Elle se sent habitée par une différence qui transcende sa vie terne à South Richmond, sa ville morose. Cette différence, elle essaye de se l’expliquer, notamment en fantasmant sur le 1/16ème de sang indien qui coulerait dans ses veines. Elle manifeste une véritable fascination pour la culture de la tribu siwash dont elle est très lointainement issue.
Even cow-girls get the blues… Quel titre formidable ! Plein de promesses… Sissy Hankshaw a été dotée à sa naissance des deux plus longs pouces du monde ! Ses pouces, elle les vit comme une part d’elle-même qu’elle ne comprend pas, qui la dépasse et qui l’entraîne. Dans une première période de sa vie de jeune adulte, elle accueille ça comme un cadeau. Elle se sent habitée par une différence qui transcende sa vie terne à South Richmond, sa ville morose. Cette différence, elle essaye de se l’expliquer, notamment en fantasmant sur le 1/16ème de sang indien qui coulerait dans ses veines. Elle manifeste une véritable fascination pour la culture de la tribu siwash dont elle est très lointainement issue.
Ses pouces l’emportent, au sens propre. Sur les routes. Elle va devenir la plus grande autostoppeuse des Etats-Unis, traversant le pays en tous sens pour le seul plaisir du voyage, tirée par une force irrépressible, un appel impérieux. Cette frénésie de stop amène des rencontres, dont certaines qui peuvent sembler dangereuses, avec des hommes entreprenants. Mais cette expérience constitue, en quelque sorte, son éducation. Elle découvre le monde, apprend les êtres, se sent vivre intensément, et se construit une personnalité unique. Les gens autour d’elle, ceux qui l’aiment, veulent pourtant la libérer de cette emprise de ses pouces. Ils pensent que ce serait bon pour elle de se normaliser.
Sissy va faire la connaissance de La Comtesse, étrange personnage, homme d’affaires, dandy androgyne et obèse, qui consacre sa vie et son business à libérer les femmes de leurs odeurs corporelles intimes ! Il choisit Sissy comme mannequin vedette pour ses campagnes publicitaires. Il la voit seulement comme une très belle femme, porteuse d’une force vitale qu’il trouve inspirante. Il ne s’arrête pas à sa difformité, il perçoit ce qu’elle lui apporte. Toutefois, les photos qu’il commandite cachent soigneusement les pouces de la jeune femme…
Et l’amour ? La Comtesse lui fait rencontrer Julian, qui est indien Mohawk, mais qui s’est totalement adapté à la culture dominante, qu’il considère comme universelle. Julian vit à New-York, est aquarelliste et fréquente les milieux branchés. Il tombe très amoureux de Sissy. Ils se marient et essaient d’être heureux. Mais il pense que le besoin de bouger de sa jeune épouse, son état d’instabilité permanente, sa sensibilité à fleur de pouces lui font du tort. C’est probablement lui, avec toute la force de son amour et de son désir, qui crée le doute chez elle. Sissy, même si elle est très amoureuse elle aussi, n’arrive pas à se faire à sa nouvelle existence sédentaire. Après une première « fugue », il l’oblige à se faire hospitaliser en psychiatrie pour la libérer de sa quête intérieure. Elle entre dans la clinique du très structurant Dr Goldman. Le psychiatre a une théorie. Pour lui, il y a deux types de fous. Il y a « Ceux dont les instincts primaires ont été égarés, émoussés, troublés ou brisés à un très jeune âge par des facteurs de milieu de vie et/ou biologiques échappant à leur contrôle. Seul un nombre réduit de ces individus peut retrouver complètement et de façon permanente cet équilibre que nous appelons ‘santé mentale’. Mais on peut leur permettre de faire face à la source de leurs ennuis, de les compenser, de diminuer les substitutions désavantageuses qu’ils opèrent et de s’adapter assez pour vivre la plupart des exigences sociales sans de douloureuses difficulté[2] ». « Ma joie dans la vie est d’aider à l’adaptation de ces personnes » ajoute-t-il. « Mais il y a d’autres gens, des gens qui choisissent d’être fou pour affronter ce qu’ils tiennent pour un monde dément. Ils ont adopté la folie comme style de vie ». Malgré que les « problèmes » mentaux de Sissy « auraient dû » entrer dans la première catégorie, il arrive à la conclusion qu’elle appartient à la seconde. Or le Dr Goldman étant « frustré, embarrassé et même légèrement effrayé » par cette seconde catégorie, il va confier le cas à un de ses assistants, le remuant Dr Robbins, jeune psychiatre en pleine recherche de sens. Robbins, pour qui aider Sissy consiste à se laisser aller à la fascination pour elle, son histoire, et les perspectives de sens qu’elle lui ouvre, à lui. Robbins comme l’auteur, qui assurera pendant tout le bouquin que c’est bien de lui qu’il s’agit. Car, tout au long de l’histoire, Robbins s’adresse au lecteur, à lui-même, aux objets, aux nuages, et à ses personnages. Il questionne leurs choix, leurs attitudes. Ces créations sorties de son imagination, Il leur parle. Et c’est manifestement un dialogue qui l’éclaire, qui l’inspire.
Un moment clé du roman est cette invraisemblable conversation entre Le Cerveau et Le Pouce. « Il y a une incandescence surnaturelle. Elle vient d’une dimension que nous ne comprenons pas encore. Dans cette aurore céleste se rencontrent deux choses animées. En nous accoutumant à la lumière qui forme la substance de ce ‘paysage’, nous reconnaissons l’une des deux choses comme un cerveau humain. L’autre s’avère être un pouce. Le Cerveau repose en toute placidité. Le Pouce, qui n’a fait son apparition sur la scène que récemment, nous donne le sentiment inverse ; il paraît agité. ‘Pourquoi cet air amer, vieux frère ?’ demande le Cerveau ». Le thème du dialogue qui suit, c’est l’évolution de la civilisation humaine. Et la responsabilité. Est-ce, comme le présente l’anthropologie, le pouce, opposable aux autres doigts, instrument qui fonde l’avènement de la technologie, qui est la pierre angulaire de la civilisation ? Ou est-ce le cerveau qui, en développant son cortex, a suscité des idées nouvelles, une attente d’évolution ? Qui est responsable de la civilisation ? Le corps ou la pensée ?
Mais même les cow-girls… évoque encore d’autres facteurs de troubles dans la civilisation[3]. Et, d’abord, les luttes des femmes. Encore une fois, cependant, c’est par la fable d’apparence burlesque qu’il le fait. La Comtesse finance un centre, le ranch de la Rose de Caoutchouc, qui propose à des bourgeoises d’âge mûr des séjours consacrés aux soins de beauté et au bien-être[4]. Mais c’est aussi un ranch perdu dans la prairie au Dakota du sud. Il est administré par une bande de jeunes femmes qui se retrouvent autour du rêve d’être reconnues comme cow-girls. Elles ont pris le pouvoir sur la directrice désignée par La Comtesse, et le contrôle sur le ranch et sur les activités du centre. Elles les orientent très fortement vers la découverte du corps et du plaisir féminin. En effet, ces créatures, sous la conduite de leur cheffe, la belle Bonanza Jellybean, constituent une sorte de communauté d’amazones, qui vont croiser la destinée de Sissy. Elles consacrent leur existence aux travaux du ranch, aux exercices de tir, au sexe récréatif soit solitaire, soit entre elles ou avec des partenaires masculins de rencontre et à la consommation de champignons hallucinogènes.
Ce ranch est dominé par une montagne (Siwash( !) Ridge) au sommet de laquelle vit un ermite, surnommé Le Chinetoque, vieux sage farouche dont Sissy découvrira l’histoire et la rencontre avec le Peuple de l’horloge, tribu indienne troglodyte qui a réfléchi sur le message caché du grand tremblement de terre de San Francisco[5], et a fui les villes et la civilisation des blancs pour reconstruire une communauté fermée, dans l’attente de la fin de cette civilisation. La tribu vit dans un réseau de grottes, selon des rituels alambiqués, centrés sur le rapport au temps, un temps réinventé, à l’écoulement fluctuant, voir chaotique, rythmé par un mécanisme horloger secret sur lequel veille la communauté.
Et puis, il y a les grues blanches… Des animaux majestueux, magnifiques, des êtres hors du commun qui évoquent la pureté et la liberté de la nature sauvage. Mais aussi sa fragilité. Habituellement, elles effectuent chaque année leur migration entre deux zones identifiées. On les attendait à Aransas, Texas, pour l’hiver, mais elles n’y sont jamais arrivées. Elles ont pourtant bien quitté leur lieu de nidification, au nord du Canada. Elles ont disparu ! Or, il s’agit d’une espèce en voie d’extinction. Et, bien sûr, c’est l’activité humaine qui les menace. Les quelques dizaines d’individus restant sont suivis dans le cadre d’un programme de protection[6]. Elles sont l’objet de toutes les attentions, et leur disparition suscite l’émotion de la communauté scientifique, de la presse, du ministre de l’intérieur, et même celle du président. Bien entendu, l’épisode des grues a quelque chose à voir avec le ranch de la Rose de Caoutchouc. C’est à la fois une péripétie burlesque, avec l’intervention des matamores de l’armée, mais aussi une sorte de présage menaçant pour l’avenir de la civilisation, qui plane sur le dernier tiers du bouquin et va prendre un tour dramatique qui détermine la fin du roman.
Et les pouces, là-dedans ? Sans vouloir rien dévoiler de l’intrigue, je dirais que l’histoire de Sissy et de ses pouces reste à l’avant-plan jusqu’au bout. C’est le fil rouge du roman. L’infirmité, donc, comme un don, à reconnaître, à cultiver ; la filiation avec un peuple acculturé comme identité forte ; la marginalité comme construction de soi ; la fragilité comme valeur ; la reconnaissance de sa propre nature profonde ; l’errance comme mode de vie ; l’ambiguïté sexuelle ; la recherche d’une identité singulière ; le refus des normes de genre : même les cow-girls…, d’un bout à l’autre, célèbre la marge, le hors norme, l’inadapté. Il ne s’agit pas seulement de tolérance au bénéfice des individus concernés, mais aussi d’une ouverture à ce qui bouscule pour rendre vivante la vie sociale.
Cette ouverture suppose un trouble. Les ‘autres’ personnages, celles et ceux qui incarnent la norme dans cette histoire, ne sont pas, pour la plupart, dans une attitude de rejet autoritaire. Ils sont désabusés, habités par une espèce de tristesse, de désarroi face à l’expérience de la vie humaine. Face à ceux qui perturbent la norme, ils manifestent une sorte de respect prudent pour quelque chose qui les dépasse, mais dont ils pressentent la valeur. « En dépit de son titre, le secrétaire de l’intérieur était une homme sans profondeur »
Ce roman est présenté dans la presse comme l’ouvrage le plus important de la contre-culture américaine. Sissy, les cow-girls, le chinetoque, le peuple de l’horloge, sont des oracles, aveugles (tel Tirésias) ou clairvoyants, en retrait ou aux prises avec une société qui est en train de se perdre.
On peut penser que j’ai défloré le roman. Il n’en n’est rien. Il y a des dizaines d’autres anecdotes, personnages et situations Mais, surtout, je n’ai pas dit l’essentiel. Et je ne pourrais pas le dire. Parce que l’essentiel est dans la forme. Je viens d’essayer de partager ce qu’évoque ce récit. Mais il manque le cœur, l’âme. L’invraisemblable liberté de la langue de Robbins. Chaque métaphore est une pure invention, même pour servir les propos les plus anodins. Les phrases courent toutes seules, et on chevauche les mots avec lui dans un élan jamais contraint par le sens. Mais qui ouvre au sens. Qui inspire. Ce rapport à la création, au langage, à l’imaginaire marque fondamentalement l’accueil de l’imprévisible, de l’incontrôlé qui est au centre de cette œuvre.
Qui a écrit ? Quelle force, quelle volonté ? On a l’impression que Robbins écrit en-dehors de sa volonté, au-delà de lui-même. Du coup, il nous parle au plus profond de notre sensibilité, en-deçà de notre rationalité. Et évidemment, on comprend tout : « Il n’y a qu’une seule chose qui vaille mieux que le bonheur dans cette vie et c’est la liberté. Il est plus important d’être libre que d’être heureux ».
Références
[1] Tom Robbins ; even cowgirls get the blues ; Houghton Mifflin, Boston ; 1976.
Adel, Balland ; Paris, 1978 pour la 1ère édition française. Réédition chez Gallmeister en 2010.
Adaptation au cinéma par Gus Van Sant en 1993, avec Uma Thurman dans le rôle principal.
[2] On pense aux controverses sur la définition du rétablissement. « En général, les modèles cliniques professionnalisés ont tendance à se concentrer sur l’amélioration des symptômes et des fonctions particulières, et sur le rôle des traitements, tandis que les modèles des consommateurs / survivants ont tendance à mettre davantage l’accent sur le soutien par les pairs, l’autonomisation et une réelle expérience personnelle du monde » (source Wikipedia)
[3] Je ne peux m’empêcher de penser à S. Freud et son Malaise dans la Culture, paru en 1930, et longtemps traduit en français sous le titre Malaise dans la Civilisation.
[4] Le bouquin sort en 1976 !
[5] Le dernier grand tremblement de terre de cette région a été provoqué par un mouvement le long de la faille de San Andreas, en 1906. The Big One est le nom donné à un tremblement de terre dévastateur qui devrait survenir sur la côte ouest des États-Unis. Ce phénomène se reproduirait périodiquement, tous les 150 ans environ avec une probabilité de 62 % qu’il se produise avant 2032. Les Américains s’attendraient donc au prochain Big One.
[6] La grue blanche n’a jamais été très répandue et le nombre d’individus n’a probablement jamais dépassé 1500, mais il n’en restait que 21 en 1941. En avril 2007, il y avait 340 grues blanches à l’état sauvage et 145 individus en captivité.
Un petit groupe expérimental a été introduit dans les Montagnes Rocheuses à l’ouest des États-Unis et un autre groupe de même nature mais sédentaire est établi dans le sud-est en Floride.
La reproduction en captivité, l’aide à la migration et la loi sur les espèces en danger ont sauvé la grue blanche. Mais le développement humain le long de ses routes migratoires et la réduction de la diversité génétique depuis la précédente chute de population restent problématiques. (source wikipedia)
