Quand les mots ne collent pas aux maux
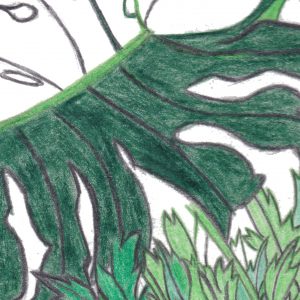
Auteur : Joseph Gatugu, philosophe
Résumé : L’article suivant est un rapport commenté d’un entretien que j’ai eu avec un migrant souffrant accompagné par l’asbl Tabane. Il met en exergue la difficulté d’expression des grandes souffrances relative à la méconnaissance de la langue de l’interlocuteur et à l’ampleur des souffrances subies. Quand les mots utilisés ne collent pas aux maux, le locuteur recourt au langage non verbal relevant de son univers culturel. Cela occasionne des problèmes de communication interculturelle dans la relation thérapeutique. Mais ces problèmes peuvent être atténués par l’empathie.
Temps de lecture : 15 minutes
La présente réflexion résulte des entretiens que j’ai eus avec un migrant (1) sur sa situation migratoire et plus particulièrement sur ses souffrances psychiques vécues dans son pays d’origine et dans le pays d’accueil. S’articulant sur ses récits de vie passée et présente et, par ricochet, sur ceux d’autres migrants souffrants rapportés par des professionnels de santé mentale (2), cette réflexion lève un coin de voile sur la difficulté, pour des migrants souffrants, à dire leurs maux ou à coller des mots à leurs maux et ainsi pouvoir se faire comprendre. Ce qui hypothèque le recouvrement rapide d’une bonne santé psychique ou mentale (3).
Dire et vouloir dire
Les penseurs de l’identité narrative (4), Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Hannah Arendt et Paul Ricœur principalement, affirment que la première forme d’identité à laquelle un individu (ou une communauté) accède est narrative. Selon eux, l’appréhension primitive de soi est médiatisée par les histoires. Ainsi, explique Hannah Arendt, « Répondre de façon approfondie à la question “qui suis-je ?”conduit à raconter l’histoire d’une vie » (5). C’est ainsi que mon interlocuteur s’est présenté à moi. Il m’a raconté son histoire. Pas toute l’histoire de sa vie évidemment mais plutôt celle qui l’a fortement marqué, à savoir celle de ses souffrances consécutives à sa détention pénitentiaire, qu’il raconte également à tous ceux qui la lui demandent. Et même celle-là n’a pas été racontée en entièreté, par faute de temps. Plus explicitement, il m’a juste raconté quelques épisodes saillants de sa vie de souffrance et la manière dont ses interlocuteurs institutionnels belges les ont accueillis. Pour lui, raconter cette histoire participe du processus thérapeutique. Cependant, il regrette que ses interlocuteurs ne le croient pas. Ses récits ne paraissent pas convaincants comme s’il mentait sur son état de santé psychique. Comment les convaincre ? Telle est la question que se posent bien de migrants confrontés aux interrogatoires similaires. Ce qui leur est en effet demandé est de prouver qu’ils sont réellement souffrants. Pour ce faire, ils sont sommés de produire un discours approprié, un discours convaincant, un discours type. Et ce discours doit être idéalement répété tel quel à chaque entretien. Il est interdit aux migrants de se tromper, d’oublier dans ses moindres détails la première histoire racontée et, pire, de se contredire. Bref, il est attendu d’eux qu’ils disent LA VERITE. Mais quelle vérité ? s’interrogent souvent les migrants. A ce sujet, témoigne le migrant rencontré : « Beaucoup de personnes m’ont demandé ce qui m’est arrivé. Je l’ai dit. Une femme italienne m’a demandé de dire la vérité, ce que j’ai réellement vécu chez moi. Je lui ai dit que j’ai été emprisonné au camp Boiro. Est-ce que vous connaissez le camp Boiro ?… C’est une prison redoutable. C’est la vérité. Mais je n’ai pas eu l’impression qu’elle a été convaincue de ce que je lui ai dit. J’étais triste ». Bien plus, il est attendu des migrants une attitude ou un comportement d’une personne qui souffre réellement ; ils doivent dès lors présenter des signes pathologiques ou des symptômes classiques d’une maladie ou d’une souffrance déclarée. Bref, les migrants souffrants doivent pouvoir être identifiés comme tels par leurs examinateurs ; ils doivent être comme d’autres malades connus. Ils doivent dès lors être confirmés ou reconnus comme tels par leurs examinateurs. Ils doivent idéalement correspondre à un malade type. Cela est cependant difficile pour les migrants. La difficulté fondamentale est d’ordre culturel. Elle est essentiellement liée au langage et à la compréhension mutuelle. Le migrant ne connaît pas parfois la langue de son interlocuteur. Il ne sait pas dire tout ce qu’il a sur le cœur. Toutefois, s’il le demande, il peut bénéficier d’un traducteur ou d’un interprète. Cependant, il se pose dans ce cas le problème de la bonne traduction/interprétation : traduire, c’est trahir, dit-on. Un traducteur ou un interprète qui comprend bien et sait bien traduire ou interpréter ce que disent et veulent dire le migrant et son interlocuteur est rare. Par ailleurs, l’intervention d’une tierce personne dans l’échange du migrant souffrant et son examinateur peut être ambivalente ; elle peut créer des interférences. Quand bien même le migrant connaîtrait la langue de son interlocuteur, bien d’autres problèmes se poseraient : la maîtrise des subtilités linguistiques, la polysémie des mots et des expressions utilisés, de la gestuelle, des silences, du regard, des larmes, des cris, des agitations, etc., bref, tous les moyens d’expression des sentiments ou du vécu relevant des univers culturels différents. A ce sujet par exemple, le français belge n’est pas tout à fait le même que le français rwandais ou libanais. Ainsi témoigne le migrant avec qui je me suis entretenu : « J’ai parlé à un docteur. Je n’avais pas d’interprète. Je sais dire quelque chose en français mais je pense que ce docteur n’a pas compris ce que j’ai dit. Je voulais dire beaucoup de choses mais c’était impossible. Je lui ai dit comment j’ai été torturé en prison mais il ne m’a pas cru. Pourtant, je disais la vérité. Je n’ai pas menti. Je me suis énervé sur le docteur … J’ai pleuré… Je suis allé m’enfermer en chambre et j’ai prié jusqu’à 2 heures du matin… ». Le problème soulevé ici peut être clarifié dans ces termes de Paul Ricœur : « Comment recevoir, comme dans un exercice de traduction, en quelque sorte, le message des autres, dans une sorte d’hospitalité langagière, cette vérité des autres qui n’est peut-être pas dite dans ma langue ? » (6).
Un autre problème d’ordre communicationnel relevé dans le récit du migrant est le fait qu’il lui manque parfois des mots pour dire ce qu’il vit ou ce qu’il a vécu ; son lexique est limité. Il lui manque surtout des mots justes, des mots compréhensibles par son locuteur. « Je n’ai pas des mots pour dire comment j’ai souffert en prison… J’ai connu beaucoup de choses. Ma femme était aussi emprisonnée là mais je ne la voyais pas. Nous y avons passé beaucoup d’années, sans être jugés. Nous étions emprisonnés injustement… », témoigne mon interlocuteur.
Tout ne se dit pas par les mots
Un dernier problème d’ordre communicationnel relevé dans le récit du migrant est fondamental. Parfois, le migrant ne veut pas dire tout ce qu’il a vécu ou ce qu’il vit encore surtout lorsque c’est traumatisant. Le dire lui ferait très mal. Dès lors, il préfèrera le taire pour ne pas en souffrir encore. Je l’ai constaté dans notre échange, notamment au travers de ses silences. La remémoration des atrocités de la prison, de l’injustice subie, bref des causes de sa souffrance est de nature à raviver les plaies psychiques encore ouvertes. Ainsi me confiait mon interlocuteur à ce sujet : « J’ai vécu des choses terribles. En prison, chaque jour, je m’attendais à la mort. Ce que j’ai vécu est grave… Je n’ai pas des mots pour le dire… Je vais me taire. Même si je te le dis, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne connais pas la prison de Boiro… ».
Ce témoignage montre toute la difficulté à dire l’horrible, l’enfer carcéral en l’occurrence. Celui-ci est pour ceux qui en ont l’expérience de l’ordre de l’indicible. Incapable de trouver des mots à mettre sur ses maux, mon interlocuteur ponctuait ses phrases par des silences et des larmes. Ce langage des larmes est très expressif. Il exprime une souffrance débordante. Dans certaines sociétés africaines en particulier, ce langage est extrême. Pleurer est réservé aux femmes et aux enfants. C’est interdit aux hommes. Ce qui leur est interdit n’est pas pleurer comme tel mais plutôt laisser couler des larmes sur leurs visages ; ils doivent plutôt les retenir en eux ou, comme on dit au Burundi, « les faire couler dans le ventre ». Pleurer en montrant ses larmes est interprété comme une manifestation de faiblesse de caractère ou de non-maîtrise de soi. Dès lors, si un homme en arrive là c’est qu’il n’en peut plus.
A tout prendre, cette attitude de mon interlocuteur se présente comme un appel à se mettre dans la peau du migrant, à sentir sa douleur, à se représenter ce qu’il a vécu en prison, son déracinement, son exil, sa perte des repères culturels, sa peur de l’avenir, son difficile enracinement dans le pays d’émigration, sa solitude, sa dépendance vis-à-vis des services sociaux et sanitaires, sa difficulté à se projeter dans l’avenir, etc. Certes, il n’est pas facile de se mettre dans la peau d’un tel migrant, de se transposer dans son psychique pour savoir ce qu’il a vécu et vit réellement. Mais ce qui est demandé est d’approcher sa souffrance dans une attitude bienveillante, bref, d’essayer de le comprendre un tant soit peu et se laisser toucher. Cela peut être interprété par l’Autre comme une reconnaissance de l’appartenance à une commune humanité.
Tout ceci revient à dire qu’il ne faut pas seulement le langage verbal pour communiquer avec le migrant souffrant ; d’autres langages existent. Des petits gestes de sympathie, des gestes attentionnés et bienveillants, un regard tendre, par exemple, sont plus éloquents que certains discours. Ces gestes sont fortement appréciés par le migrant. Ils mettent du baume au cœur. Ils sont interprétés comme des signes de reconnaissance de sa souffrance. Ils manifestent en effet le souci qu’on a pour lui. Savoir que les autres se soucient de lui contribue en conséquence à son rétablissement psychique. Ainsi témoigne mon interlocuteur : « Quand la directrice du centre de demandeurs d’asile m’a vu elle m’a donné un café. J’ai beaucoup aimé. Ça m’a fait du bien… ça m’a réchauffé… il faisait très froid et j’avais mal… Ça m’a calmé ».
Il en va de même du silence. Certains silences constatés lors de mon entretien avec mon interlocuteur n’ont pas été interprétés comme un signe d’absence ou le refus de dialogue, encore moins comme l’absence de quelque chose à dire. Tout simplement, c’était une autre forme de communication. Pour utiliser l’expression de Camus (7), je dirais que ces moments de silence étaient comme une respiration où mon interlocuteur reprenait ses esprits après un rappel de la gravité de ses souffrances. Ce silence appelle le silence de l’interlocuteur, un silence actif. Il sonne comme une invitation au dialogue, un dialogue silencieux, sans mots ou sans paroles, voire à la communion avec lui. Ce silence permet de sentir ce que sent l’Autre, quoiqu’imparfaitement.
Tout bien considéré, une attitude permettant une meilleure communication avec un migrant souffrant est l’empathie. Des fois même, il ne faut pas beaucoup de grands entretiens pour comprendre la souffrance du migrant. Une observation aimante et bienveillante peut parfois suffire. Ainsi témoigne mon interlocuteur : « Le médecin m’a observé un moment et au bout de quelques minutes il a compris que j’avais très mal. Il m’a juste dit : “tu es vraiment malade”. Il m’a alors donné un médicament et il m’a demandé d’aller dormir. Il était très sympathique avec moi ».
Écrire pour vider son sac
Un dernier moyen de communication susceptible de participer au meilleur rétablissement psychique d’un migrant souffrant qui a été identifié par mon interlocuteur est l’écriture. Celle-ci lui apparaît comme un exutoire de son mal-être, voire une thérapie. Selon lui, écrire permet de vider son sac et d’exorciser sa souffrance. L’écriture est dès lors un acte libérateur de la pesanteur du passé : « Je veux libérer ma tête des souvenirs douloureux ; quand j’aurai écrit tout ce que j’ai vécu, je me sentirai bien », a-t-il déclaré. Selon lui, tant qu’il n’aura pas écrit ce livre, son passé ne passera pas. Sa volonté est dès lors de rompre avec une mémoire excessive, maladive et obsédante qui pourrit sa vie. Il veut lâcher prise avec la mémoire des atrocités et se tourner vers l’avenir pour se consacrer à quelque chose d’autre de qualitatif utile à sa vie, à sa famille et à sa société d’accueil. Il veut par-là renaître de ses cendres, se reprendre en charge, s’assumer pleinement, concevoir des projets, bref, exister. Il veut finalement donner un autre sens à sa vie. A y regarder de plus près, son projet répond à cette parole de sagesse de Ricœur (8), « Si, en effet, les faits sont ineffaçables, si l’on ne peut plus défaire ce qui a été fait, ni faire que ce qui est arrivé ne le soit pas, en revanche, le sens de ce qui est arrivé n’est pas fixé une fois pour toutes ».
Cependant, il sait que son projet d’écriture est difficile à réaliser à cause, principalement, de son français approximatif, ses compétences rédactionnelles limitées, sa méconnaissance des exigences du monde de l’édition, etc. Conscient de ses limites, il en appelle aux personnes de bonne volonté. L’aide la meilleure qu’on lui rendrait d’abord est le peaufinage de son projet et la clarification de ses idées. En effet, mon interlocuteur veut tout écrire, tout ce qu’il a vécu, principalement en prison. Or, c’est beaucoup de choses. Une vie ne suffirait pas pour cela. L’idée de récit exhaustif étant performativement impossible, il lui faudrait dès lors sélectionner des épisodes les plus saillants pour lui mais aussi pour les autres auxquels il destine le livre (9). Ce livre est en effet conçu comme un témoignage sur l’enfer carcéral de la prison de Boiro dans laquelle il a été enfermé durant des années et où des milliers de personnes ont péri psychiquement et physiquement. Par ailleurs, il lui faudra un soutien psychologique pour qu’il puisse remuer ses souvenirs douloureux et sortir gagnant de son combat contre ses démons. Il faudra pour ce faire du temps suffisant pour qu’il puisse ramener au grand jour des souvenirs enfouis. Pas beaucoup de temps cependant, puisqu’avec son âge avancé, ses souvenirs risquent de s’effacer de sa mémoire. En attendant de « coucher ses maux sur le papier » (10), force serait qu’il se raconte son histoire et qu’il s’enregistre. Il réécoutera de temps en temps ses enregistrements pour en apprécier la cohérence et la véracité et boucher les trous de mémoire éventuels. Cela lui facilitera le travail d’écriture futur.
Concluons cette réflexion en soulignant l’importance du récit dans le processus thérapeutique du migrant : « Tous les chagrins sont supportables si on en fait un conte ou si on les raconte », affirme Isak Dinesen (11). Il en est de même d’autres souffrances psychiques, à l’instar de ceux de mon interlocuteur et d’autres migrants ayant vécu des expériences similaires à la sienne. (Se) raconter et écrire et ainsi mettre des mots sur son vécu douloureux participent à l’apaisement psychique du narrateur ou à la décantation de sa souffrance (12). Cela s’avère plus efficace dans un cadre dialogique où le narrateur s’adresse à un interlocuteur qui lui prête une oreille attentive et essaie de le com-prendre, c’est-à-dire de le rejoindre dans sa souffrance.
Références
- J’ai rencontré ce migrant à l’asbl Tabane située à Liège. Je l’avais rencontré plusieurs fois auparavant chez Lire et Ecrire, dans le cadre de l’apprentissage du français.
- Voir à ce sujet le dossier : « Exils et appartenance », in Confluences, n° 21, décembre 2008 ; Dauvrin, Marie, Geerts, Charlotte et Lorant, Vincent, Santé des migrants et bonnes pratiques. Résultats belges du projet EUGATE, Santé conjuguée, n° 51, janvier 2010, pp. 19-25. Le dossier « Santé mentale et migration », in La Lettre de l ’ IRFAM – Diversités et Citoyennetés, n° 25, I/2011. (Consulté le 11/09/2017).
- La santé psychique ou mentale est prise ici dans le sens que lui en donne l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir « un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter des tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté » (Consulté le 13/7/2017)
- L’identité narrative est l’identité résultant des histoires qu’on (se) raconte.
- Arendt, Hannah, La Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961.
- In Andres, Laurent, Entretien Hans Küng-Paul Ricœur autour du Manifeste pour une éthique planétaire (Ed. du Cerf) de Hans Küng. Les religions, la violence et la paix. Pour une éthique planétaire, ARTE, 5 avril 1996. (Consulté le 24/8/2017).
- Camus, Albert, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942.
- Ricœur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris : Seuil, 2000, p. 496.
- Lire à ce sujet Ricœur, Paul, Fragile identité : Respect de l’autre et identité culturelle, 2000. En ligne : http://www.fondsricoeur.fr/photo/FRAGILE%20IDENTITE%20V4.pdf (Consulté le 29/12/2013).
- Telle est une partie du titre d’un article de Valérie Colin-Simard portant sur le rôle thérapeutique de l’écriture « Littérature : coucher ses maux sur le papier » (consulté le 22/9/2017).
- Citée par Arendt, Hannah, in cit., p. 231.
- Il est intéressant de lire à ce sujet Ferry, Jean-Marc, Les Puissances de l’expérience. Essai sur l’identité contemporaine, t.1, Le Sujet et le verbe, Paris, Éditions du Cerf, 1991, p. 107.

