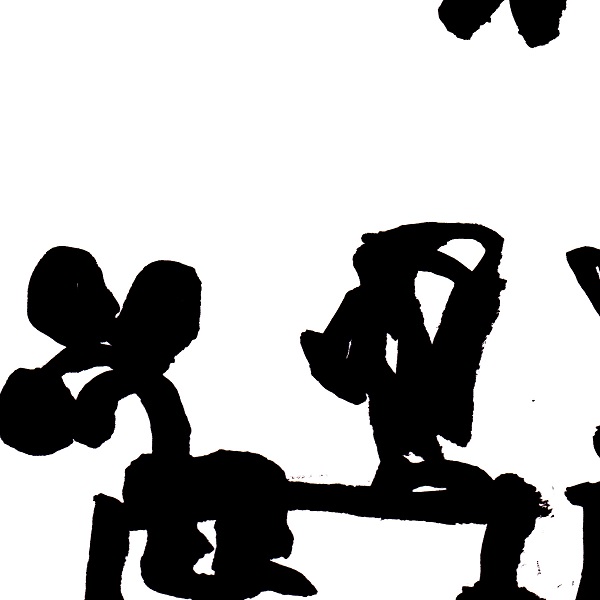Liberté et propriété de soi
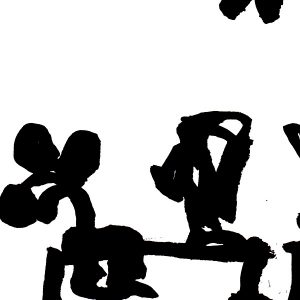
Auteur : Emeline Deroo, philosophe et animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : La notion de liberté est l’épicentre du courant de pensée libertarien. Celle-ci est revendiquée comme un droit, le droit de posséder et de décider librement sur ce qui m’appartient. Si, d’un point de vue libertarien, posséder quelque chose signifie le droit de conserver, exploiter, vendre, transférer cette chose, la possession peut inclure aussi le droit de la détruire ou de l’aliéner. Si l’on suit cet argument, qu’en est-il alors de notre corps, entendu comme propriété ? Quels problèmes pourraient se poser ? Cette question constituera le fil de notre réflexion.
Temps de lecture : 15 minutes
Liberté et propriété de soi : disposer de son corps ou être dépositaire d’une commune humanité
La notion de liberté est l’épicentre du courant de pensée libertarien, né dans les années septante aux Etats-Unis, qui eut d’abord une influence déterminante dans la culture nord-américaine puis, un peu plus tard, dans nos contrées. Ce courant couve diverses tendances théoriques et politiques, se réclamant toutes ou presque de « libertariennes », dont la valeur commune est l’attachement à la liberté individuelle. Dans ce courant de pensée, la liberté individuelle est revendiquée comme un droit, le droit de posséder et de décider librement sur ce qui m’appartient. Robert Nozick[1] définit ce droit de propriété comme suit : « l’élément central de la notion d’un droit de propriété sur X est le droit de déterminer ce qui sera fait de X ». Sous son apparence neutre et juridique, cette définition pourrait pourtant dissimuler des enjeux de taille. En effet, si, d’un point de vue libertarien, posséder quelque chose signifie le droit de conserver, exploiter, vendre, transférer cette chose, la possession peut inclure aussi le droit de la détruire ou de l’aliéner. Si l’on suit cet argument, qu’en est-il alors de notre corps, entendu comme propriété ? Quels problèmes pourraient se poser ? Cette question constituera le fil de notre réflexion.
Pour les libertariens, la garantie de la liberté individuelle de chacun comme droit fondamental n’est possible que par la réduction drastique du rôle de l’État dans les affaires individuelles. L’État n’a pas à s’ingérer dans mes choix quant à ce qui m’appartient pour autant, premièrement, que je ne nuise pas à autrui et à ce qui lui appartient et, deuxièmement, que l’acquisition de mes biens soit réalisée de manière légitime (par appropriation originelle, don ou achat). Aux yeux d’un libertarien, toutes les autres prérogatives habituelles dont dispose l’État dans les différents domaines (l’éducation, la santé, la recherche, la culture, le social, l’agriculture, etc.) sont autant d’obstacles à la liberté de chacun d’entreprendre et de choisir son propre mode de vie. Dès lors, ces domaines devraient être privatisés et certainement pas organisés et financés – dictés – par un gouvernement.
Or, un reproche régulièrement adressé à cette conception libertarienne porte sur le caractère fictif de cette notion de liberté : bien que, dans le principe, tout le monde dispose d’une même liberté au départ, rien ne garantit que tous y auront également accès ! Cette liberté n’est pas du tout substantielle et ne contrecarre aucunement les inégalités de fait qui existent entre les parcours des individus.
En tant que la propriété de soi-même constitue un droit naturel fondamental, la question de la propriété du corps s’impose ici comme un enjeu central. Si cela est aujourd’hui une évidence pour de nombreux défenseurs de la liberté individuelle, cette idée n’est pas toujours allée de soi. Elle est le résultat d’une évolution historique majeure dans le champ juridique : en s’appuyant sur le droit individuel de chaque homme de disposer de soi et de ses biens, le libertarisme a progressivement évincé le régime de protection juridique du corps, s’articulant autour d’une conception classique du droit, en lui substituant un régime de disposition[2] de ce même corps. Dans le droit naturel classique, les lois étaient les gardiennes de l’indisponibilité du corps et de l’état civil d’une personne : l’âge, le sexe, la filiation et la nationalité étaient, par définition, des éléments biographiques déterminés et non modifiables. Dans le droit contemporain, ces déterminations jusqu’il y a peu intangibles tendent à devenir malléables en vertu de la libre disposition du sujet quant à sa propre personne – en témoignent les différents textes de loi internationaux portant sur les droits et libertés de l’individu à disposer de lui-même. En résumé, alors qu’auparavant le droit avait pour fonction de protéger l’individu (et, implicitement, son corps) de toutes les violences (symboliques, morales ou physiques) qui pouvaient lui être infligées, aujourd’hui, le droit a essentiellement pour fonction de garantir à l’individu la libre « utilisation » de son corps, ce qui est radicalement différent !
Si l’on suit cette position libertarienne jusqu’au bout, en tant que propriétaire de mon corps, je suis libre de négliger, voire de détruire ma santé, de refuser les obligations telles que la scolarité, le service militaire ou la vaccination. Je suis libre aussi de mettre fin à mon existence, de vendre mes organes, de changer de sexe, de me prostituer, d’avorter ou de procréer pour autrui. Toutes ces choses qui aujourd’hui se trouvent au cœur de controverses passionnées étaient impensables dans un passé encore assez récent (tant sur le plan juridique qu’éthique). La seule limite posée par la plupart des libertariens concerne l’esclavage : je ne peux pas utiliser ce droit (posséder mon corps) pour renoncer à ma propre liberté (en devenant la propriété d’un autre). L’esclavage serait alors un usage contradictoire de la liberté.
Parmi les éléments de controverse qui alimentent le débat sur cette conception du corps comme propriété, retenons deux considérations anthropologiques importantes.
- Premièrement, quant au rapport d’un sujet à son corps. Le philosophe Merleau-Ponty souligne l’existence de deux termes en allemand pour parler du corps : Leib et Körper. Le premier désigne le rapport incarné d’un sujet dans sa propre chair, un rapport subjectif : je suis mon corps. Le second terme (Körper), quant à lui, renvoie à une objectivation du corps, c’est-à-dire le corps qu’étudie la science comme objet : j’ai un corps, je le possède ; le corps devient ici un objet distinct du sujet. Merleau-Ponty nous met en garde : le rapport d’un sujet à son corps ne peut se réduire – sauf à considérer des situations pathologiques – à la simple possession d’un objet par un sujet (j’ai un corps) car ce serait nier la dimension incarnée, vécue du sujet dans son propre corps, sa chair (je suis mon corps)[3].
- Deuxièmement, quant à la tension entre dignité et liberté. Au fond, de quoi parle-t-on lorsqu’on prononce ce mot de dignité ? Elle a ceci de particulier qu’on ne peut pas la « perdre » : elle fait partie de notre humanité. En revanche, on peut agir de manière indigne (de sa condition humaine), on peut faire violence à la dignité d’autrui. La notion de dignité ainsi décrite renvoie alors à l’idée d’humanité commune, il s’agit de cette dignité qui, par exemple, nous interdit de torturer un criminel ou de considérer un homme dans le coma comme un simple réservoir d’organes transplantables. Quand peut-on affirmer que cette dignité humaine est bafouée ? C’est le cas, écrit le philosophe Emmanuel Kant, à chaque fois que l’homme est considéré comme un moyen et non comme une fin, c’est-à-dire comme un simple objet, comme une chose dont on peut disposer et non comme un sujet humain, digne de respect, doué d’une conscience, d’une liberté de penser et d’agir.
Définir la dignité devient acrobatique lorsque, au-delà du concept, il convient de fournir un contenu concret à cette notion de dignité. Nous le constatons régulièrement au fil des actualités : elle est bien souvent brandie comme un argument décisif, auquel on ne peut rien opposer… alors qu’il permet en réalité de défendre une chose et son contraire. Par exemple, dans le cas de l’euthanasie, où se situe la dignité ? Dans l’idée de respecter l’autonomie en chaque homme ou de respecter la sacralité de la vie ? Il en va de même dans le cas de certaines hospitalisations sous contrainte : quid de la liberté de l’individu lorsqu’on le transforme en patient sans son accord ? Un autre exemple, qui pourrait paraître trivial s’il n’était pas aussi éclairant que cynique : le lancer de nains. Cette pratique médiévale, redevenue à la mode dans les années 80 (principalement aux USA et en Australie mais aussi en France) a suscité des débats houleux. Les tenants de l’organisation d’une telle pratique et leurs contradicteurs mettaient en concurrence la liberté et la dignité. Pour les opposants au lancer de nains, cette pratique constituait un traitement dégradant à l’égard des nains, violait la dignité qui constitue notre commune humanité et donc devait être interdite. Cette position défavorable au lancer de nains fut combattue par… des nains, lesquels arguaient que l’interdiction de cette pratique aurait entravé leur liberté fondamentale de disposer de leur corps comme bon leur semblait ! Et pour cause : grâce à cette pratique folklorique, des nains ont non seulement bénéficié d’une reconnaissance qu’ils n’auraient sans doute pas connue autrement mais, aussi, l’activité étant relativement lucrative, ont perçu grâce à elle des revenus auxquels ils n’auraient sans doute jamais eu accès en raison de leur handicap. À partir du moment où les personnes concernées consentent à ce que d’aucuns jugent être une exploitation violente et ludique de leur personne, de quel droit peut-on leur interdire de le faire quand même ?
La question de la dignité dessine ainsi une ligne de partage entre deux conceptions de l’individu : la première comme unité singulière d’autonomie, libre de conscience et de volonté ; la seconde, comme dépositaire d’une commune humanité. Une conception d’inspiration libertarienne aura tendance à faire valoir l’autodétermination, c’est-à-dire le droit propre à chaque individu de décider pour sa propre personne. À l’inverse, les défenseurs d’une anthropologie valorisant l’appartenance à la communauté humaine s’appuieront davantage sur la valeur de dignité pour signifier que la liberté s’arrête là où la dignité est en péril.
Ce dernier rapport entre liberté et dignité transforme en profondeur ce que l’on entend par liberté. Telle qu’elle est définie par Thierry Pech, la dignité vient apposer une limite fondamentale à la liberté : on ne peut pas décider librement de ne pas être libre car la dignité « consiste aussi à instituer une normativité de la relation de soi à soi, à défendre l’« humanité de l’homme » contre l’homme lui-même et tous ceux qui prétendent pouvoir disposer de leur personne comme d’un bien propre ». Ainsi comprise, la dignité « ne définit pas tant un ensemble de libertés individuelles (…) qu’une part d’humanité commune inaliénable dont chacun est dépositaire sans pouvoir prétendre à son entière propriété »[4].
Toutefois, cette dernière option n’est pas sans piège, car en préférant le dénominateur commun humain plutôt que la disposition singulière de chacun sur ce qui lui appartient, on encourt tout autant le risque de reproduire le gouffre duquel on espérait protéger la dignité. La dignité érigée en diktat pourrait bien alors conduire à un encadrement répressif des comportements individuels et, par-là, à une pénalisation à outrance des conduites jugées « contraires à la dignité » simplement parce qu’elles ne vont pas dans le sens de la préservation de la personne (tabagisme, consommation d’alcool, de drogues, pratiques sportives extrêmes, etc.). Aussi, Thierry Pech nous met en garde : « on le voit, la dignité humaine est un étroit chemin de crête entre deux précipices : celui de l’individu-roi, d’un côté, et celui d’une religion de la personne humaine qui menace d’asphyxier l’individu, de l’autre »[5].
Et vous, de quel côté penchez-vous ?
Références
[1] Robert NOZICK, Anarchie, Etat, utopie, 1974. Nozick a été professeur de philosophie à l’Université de Harvard. Il s’inspire de la conception de la liberté individuelle comme propriété telle qu’elle est développée par le philosophe anglais John Locke au XVIIe siècle.
[2] Je renvoie le lecteur aux analyses de Xavier Dijon, philosophe du droit, notamment la première partie de son ouvrage La raison du corps, Bruylant, 2012.
[3] Concernant le rapport du sujet à son propre corps et les relations avec l’évolution du monde du travail, j’invite le lecteur à consulter les textes d’Alain SUPIOT, notamment Grandeur et misère de l’Etat social. Leçons inaugurales du Collège de France. Le texte est disponible en ligne : https://books.openedition.org/cdf/2249
[4] Les citations proviennent de l’article suivant : Thierry PECH, La dignité humaine. Du droit à l’éthique de la relation, Ethique publique, vol.3, n°2, 2001. Le texte est disponible en ligne : https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2526
[5] Idem.