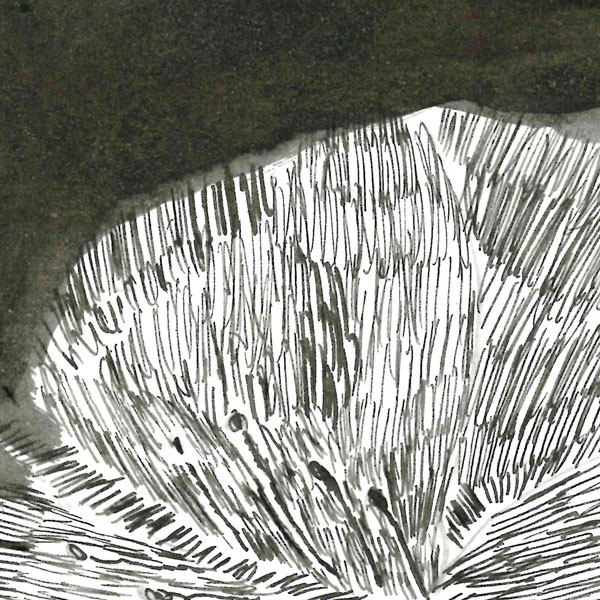Le trouble pop
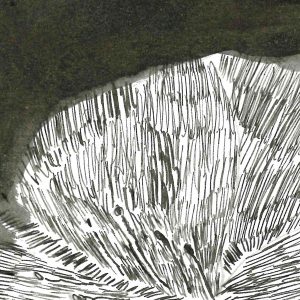
Auteur : Catherine Thieron, animatrice au Centre Franco Basaglia
Résumé : Depuis la nuit des temps, ce que l’on appelle la folie inspire la création artistique autant qu’elle fascine le public. Hélas, l’image qu’en renvoie la production culturelle, notamment audiovisuelle, est souvent bien éloignée de la réalité… Quel est leur impact sur les personnes immédiatement concernées ?
Temps de lecture : 15 minutes
1975. Le premier roman de Ken Kesey[1], inspiré de son expérience comme travailleur de nuit dans une institution psychiatrique, fait l’objet d’un long métrage qui se hisse sans difficulté dans le top 3 des films les plus populaires de l’année, juste derrière « Les Dents de la mer » : « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Miloš Forman fait l’effet d’une bombe et marque les esprits au fer rouge. Il rafle au passage des dizaines de prix et pose les jalons du film « de psychiatrie ».
Seulement voilà : c’était il y a près d’un demi-siècle, et s’il est vrai qu’à l’époque, le film attirait l’attention sur les mauvaises pratiques dans de nombreux hôpitaux psychiatriques, force est d’avouer que les procédés ont évolué davantage que les représentations toujours de mise quand il est question de trouble psychique. Le sensationnalisme est irrésistible pour les auteurs et les cinéastes, et il est plus spectaculaire de mettre en scène des comportements violents et des électrochocs forcés[2] qu’un personnage somme toute ordinaire prenant des cachets volontairement. La « folie » fascine et génère du fantasme, et le spectacle qui en est fait à des fins de divertissement dépasse rarement les stéréotypes éculés…
Dépasser les stéréotypes
« Les stéréotypes démontrent une méconnaissance des problèmes de santé mentale par la population. Les préjugés quant à eux, témoignent de sentiments forts provoqués par les conflits de valeurs qu’engendrent bien malgré eux les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale (…). Face à la folie, les généralisations hâtives et les affects président donc encore à la conceptualisation du problème pour la majorité des gens. Les conséquences de cette méconnaissance et de ces affects se traduisent généralement par un mépris, voire une hostilité affichée, pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques », soulignait Marie Absil dans une analyse intitulée « Stigmatisation : stéréotype, préjugé, discrimination »[3].
En effet, dans une étude de 2005, des chercheurs de l’Université de Melbourne ont constaté que dans les œuvres de fiction au cinéma et à la télévision, les personnes vivant avec un trouble psychique correspondent la plupart du temps à l’une des catégories suivantes : violentes et agressives, excentriques, séductrices (dans le cas des femmes), égocentriques, cobayes pour la science, simples d’esprit, et/ou losers.[4] Ces clichés participent à la stigmatisation des personnes touchées, quand elle ne les décourage pas purement et simplement de chercher une aide appropriée, comme si leur condition était une fatalité. Cette même étude souligne également que depuis l’après-guerre, le public a graduellement associé le trouble psychique grave à des comportements dangereux, alors que les personnes aux prises avec la maladie sont bien plus souvent victimes qu’auteurs de violences.
Tout le monde a entendu parler d’au moins une affaire criminelle où l’accusé, jugé non responsable de ses actes, évite la prison, comme le personnage interprété par Jack Nicholson dans « Vol au-dessus d’un nid de coucou », qui se fait passer pour « fou » afin d’être interné dans une institution psychiatrique. [5] Si l’hôpital semble préférable à la prison dans l’imaginaire collectif, dans les faits, il peut être plus difficile de confesser une hospitalisation en psychiatrie (volontaire ou non) qu’une incarcération…
Libérer la parole
Dans son livre « Pop & Psy »[6], le psychiatre Jean-Victor Blanc dresse une liste conséquente de récits fictifs et réels autour du trouble psychique, sur le grand et le petit écran comme sur les tapis rouges, et montre l’impact que la médiatisation peut avoir sur l’idée que le grand public s’en fait. Outre les représentations très éloignées de la réalité, il revient aussi sur différents « coming out » de célébrités, dont l’impact peut être extrêmement positif : « Il est réjouissant d’observer des figures populaires des arts, du sport, et de l’entertainment parler de leur trouble psychique. Au-delà de « l’anecdote people », argument utilisé par certains détracteurs pour moquer ces coming out, ces prises de parole sont porteuses d’espoir. »[7] Ainsi, quand Carrie « Princesse Leia » Fisher écrit un livre hilarant sur l’électroconvulsivothérapie qui l’a aidée à stabiliser son trouble bipolaire[8], que Lady Gaga confie avoir vécu au moins un épisode psychotique et être depuis sous traitement, que l’athlète Simone Biles fait passer sa santé mentale avant les Jeux Olympiques, ou que Britney Spears, hospitalisée sous contrainte et mise sous tutelle en 2008, récupère pleinement ses droits en 2021, ce sont autant d’exemples permettant à des personnes en difficulté de se sentir moins seules et de réaliser qu’elle peuvent demander de l’aide, mais le chemin reste long et semé d’embûches…
D’une part, « un des écueils à éviter serait (…) l’injonction à l’outing, ou à une psychologie positiviste à outrance qui viendrait imposer une norme de plus aux malades. Celle de devoir se réjouir de leur sort, celle de se conformer à un storytelling répondant aux attentes sociales et médicales, celle de l’uniformisation du vécu de l’expérience de la maladie. »[9] Par ailleurs, le seul diagnostic – pas toujours fiable, et parfois même contradictoire – est loin d’être suffisant pour être prêt à s’en ouvrir au monde et même entamer un parcours de rétablissement : sans environnement bienveillant pour prendre soin, aider, épauler, ni accès aux alternatives à la toute-puissante psychiatrie (qui n’est pas toujours la solution la plus appropriée), on est vite démuni.
Ensuite, les stigmates associés au trouble psychique sont particulièrement lourds à porter, et les représentations grossières qu’en font encore le cinéma ou la télévision enracinent davantage les discriminations à l’égard des personnes immédiatement concernées – discriminations pouvant avoir de graves répercussions sur leur qualité de vie.
Mais si l’on n’en parle pas, ces représentations ne risquent pas de changer, si ?
Enfin, cette conversation en est à peine à ses balbutiements en France et en Belgique francophone. Jean-Victor Blanc déplore ainsi le silence relatif des personnalités francophones comparé à leurs homologues anglo-saxonnes.
Ceci étant dit, les choses changent, lentement, mais sûrement : en janvier 2022, Stromae faisait grand bruit au J.T. de TF1 avec une prestation de son single « L’enfer », où il évoque la solitude et les pensées suicidaires[10] ; quelques semaines plus tard, l’humoriste Constance annule sa tournée, annonçant sans fausse pudeur être aux prises avec un épisode dépressif[11] ; en avril, la chanteuse Selah Sue, qui n’a jamais caché vivre avec la dépression, s’ouvre candidement sur sa vie sans antidépresseurs dans l’émission populaire « C à vous »[12]…
Si positifs que soient ces exemples, on ne peut néanmoins s’empêcher de se demander ce qu’il en est des personnes moins à l’aise avec la parole ou dont l’accès au monde extérieur est au mieux limité, au pire inexistant : bien qu’ils ouvrent des brèches dans les normes, les coming out de célébrités ne changent peut-être pas fondamentalement la manière dont nous percevons les personnes les plus fragilisées ou précarisées. Et, de ce fait, ils ne changent peut-être pas les normes ; tout au plus font-ils bouger les lignes…
Raconter des histoires
« Imaginez une seconde », propose l’auteur Patrick Dylan, « que vous vivez une psychose, mais que vous n’en êtes pas conscient. Selon votre réalité, tout le monde agit étrangement, mais vous agissez de manière rationnelle. Supposons également que vous avez la chance de recevoir un traitement. Cependant, parce que vous êtes au milieu d’un épisode, vous avez l’impression qu’on vous force à prendre des pilules et qu’on vous enferme. Ne serait-ce pas plus effrayant que n’importe quel film d’horreur hollywoodien ? »[13]
Bien sûr que Hollywood, même quand il s’agit d’histoires soi-disant vraies, déroule volontiers des narrations allant à l’encontre de l’exactitude, mais en l’absence d’implication des personnes ayant une expérience vécue, nous voyons la fiction transformer de grandes souffrances ou des comportements (auto)destructeurs en vignettes magnifiquement tristes et/ou terriblement brutales.
Pour les premiers intéressés, ces images renvoyées à travers le prisme médiatique renforcent bien souvent des stigmates déjà lourds à porter… au point qu’on finit, parfois, par s’y habituer.
Grands consommateurs de séries et de films, V., C. et A. ont chacun, d’une manière ou d’une autre, fait l’expérience du trouble psychique :
V. a grandi avec une mère et une sœur bipolaires. Ce n’est que quand le trouble s’est bien ancré chez cette dernière qu’il a commencé à réellement comprendre cette maladie et ne prêtait donc pas une grande attention à sa représentation médiatique auparavant : « Je voyais plus ça comme un ressort scénaristique, au même titre que la schizophrénie qui est particulièrement surutilisée dans certains genres. Aujourd’hui, je navigue entre consternation quand je regarde une série comme « Homeland » qui parvient à dépeindre par moment la bipolarité comme un quasi superpouvoir, et impressionné par la justesse de certains traitements, comme celui du personnage de Ian Gallagher dans la version américaine de la série « Shameless ». Le côté cyclique et très long terme de la maladie gagneraient à être mieux illustrés en fiction. Dans le cas de ma sœur, j’ai mis près de 3 ans à comprendre qu’elle était enfermée dans une montagne russe à perpétuité qu’il n’est possible qu’au mieux de ralentir. Je pense que cela pourrait aider les personnes impactées à mieux cerner la réalité qui deviendra la leur à cause de cet étrange trouble. »
Pour C., une représentation plus juste pourrait aussi favoriser la consultation, et donc éviter une prise en charge tardive : « Je ne reconnaissais pas ma réalité à l’écran, et il a fallu énormément de temps pour mettre un mot sur mon état… parce que c’est un mot qui dérange et qui fait peur. Il m’a ensuite fallu faire la paix avec ce mot, dont l’essence est fortement déformée par l’image qu’en renvoient les médias. Ça ne facilite pas le partage, car l’entourage s’en fait souvent une idée très caricaturale, faute d’autres représentations. J’ai cependant l’impression que c’est en train de changer petit à petit, que les gens sont plus conscientisés, mieux informés… »
A., quant à lui, prend tout ça avec beaucoup de recul : « De manière générale, j’ai l’impression que la pop culture dépeignant des personnages troublés les tape dans des cases, avec une vision des troubles complètement édulcorée parce que leur but n’est pas forcément de parler des troubles, mais de mettre un peu de relief permettant de définir et d’identifier un personnage rapidement. C’est souvent de cet ordre-là plus qu’une volonté narrative… En tous cas, c’est mon impression devant des séries grand public de type Netflix, et c’est donc un peu « normal » de ne pas en attendre grand-chose. »
Démonter les barrières
Dans bien des cas, (faire semblant de) s’habituer à l’absence de nuance dans certaines représentations peut être le reflet d’une pudeur, d’un désir de discrétion, d’un besoin de préserver son intimité, voire sa réputation et sa sécurité physique, de la même manière que, pendant beaucoup trop longtemps (et encore bien trop souvent), les violences domestiques ou encore l’homosexualité n’avaient aucune existence publique. Et si un début de réponse se situait dans la recherche d’intersections ? Dans la rencontre entre personnalités publiques et privées, entre médias et politiques, dans la convergence des luttes aussi… Après tout, il n’y a pas si longtemps que ça (jusqu’au 17 mai 1990, précisément), l’homosexualité était considérée comme une maladie mentale par l’Organisation Mondiale de la Santé, et avant 1976, en Belgique, une femme n’était pas autorisée à ouvrir un compte en banque sans l’accord de son père ou de son mari. C’est parce que des personnes se sont organisées pour faire entendre leur voix que, petit à petit, les mentalités ont évolué… faisant ainsi évoluer le cadre légal.
La souffrance psychique étalée au grand jour a quelque chose de dérangeant, de gênant, d’effrayant, de bouleversant aussi… Et bien sûr, elle bouleverse et secoue avant tout les premiers intéressés au plus profond d’eux-mêmes, comme en témoigne l’auteure et activiste Scarlett Curtis dans l’introduction de l’ouvrage collectif « It’s Not OK To Feel Blue (and other lies) » : « Les mots et les images peuvent être puissants (…) [Ils] ont le pouvoir de réconforter, de provoquer et de créer des sentiments. Les mots et les images peuvent être utilisés en bien, mais ils peuvent aussi, sans que ce soit la faute de l’écrivain ou du créateur, causer une douleur extrême. (…) Certains jours, être confronté à une œuvre d’art qui vous rappelle votre traumatisme peut être une belle chose ; cela peut vous faire vous sentir moins seul, et une certaine beauté se dégage du fait de voir le reflet de votre propre expérience. Mais d’autres jours, cela peut être trop difficile à gérer. Quand vous êtes fatigué, un peu bouleversé ou tout simplement pas d’humeur, c’est acceptable de refermer le livre, d’éteindre la télé, de quitter le cinéma. »[14]
Tout comme il y a eu la Pride et #MeToo, on peut espérer voir émerger une réelle libération de la parole autour du trouble psychique, car la multiplication des représentations nuancées ne bénéficie pas seulement aux personnes immédiatement concernées : c’est la société dans son ensemble qui peut en tirer profit.
Références
[1] Ken Kesey, « One Flew Over the Cuckoo’s Nest », Viking Press, 1962 ; « Vol au-dessus d’un nid de coucou » traduit de l’anglais par Michel Deutsch, Stock, 1963.
[2] Si l’électroconvulsivothérapie (ECT) est toujours employée dans certains cas de dépressions et de psychoses résistantes aux psychotropes et aux neuroleptiques, celle-ci se déroule avec l’accord du patient et sous anesthésie générale.
[3] Voir la série « Stigmatisation et santé mentale » publiée sur notre site entre mars et novembre 2015.
[4] Pirkis J., Blood R., Francis C., Mccallum K. « A review of the literature regarding fictional film and television portrayals of mental illness » (2005).
[5] Voir notre analyse « Folie furieuse : la fin d’un mythe ? », 1er juillet 2022.
[6] Jean-Victor Blanc, « Pop & Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre le trouble psychique ». Plon, 2009 ; L’Abeille Plon, 2022.
[7] Ibid.
[8] Carrie Fisher, « Shockaholic », Simon & Schuster, 2011.
[9] Jean-Victor Blanc, « Pop & Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre le trouble psychique ».
[10] Journal de 20h, TF1, 9 janvier 2022. https://youtu.be/YAG6nj7Sff8
[11] https://www.facebook.com/constance.lavraie/posts/474460637372390
[12] C à Vous, France 5, 5 avril 2022. https://youtu.be/6Gd4qYTTf34
[13] Patrick Dylan, « From Villain to Hero: Reimagining the Role of Mental Health in Pop Culture », 14 juin 2021 : https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/June-2021/From-Villain-to-Hero-Reimagining-the-Role-of-Mental-Health-in-Pop-Culture
[14] In « It’s Not OK To Feel Blue (and other lies) : Inspirational people open up about their mental health », Penguin, 2020.