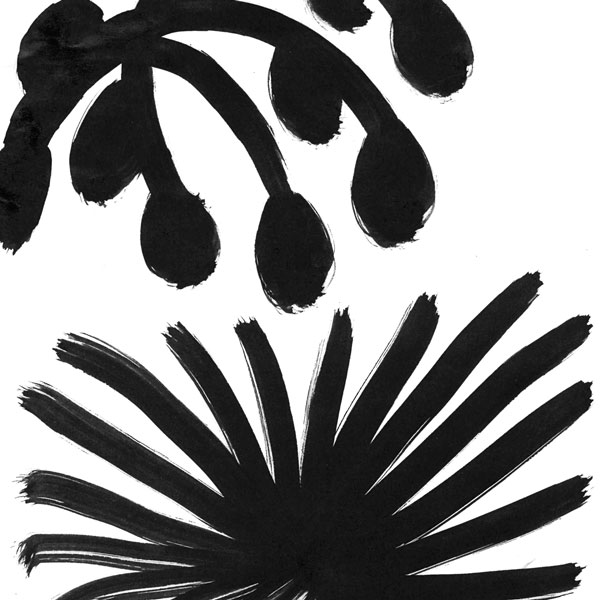Un salon d’arrangeurs
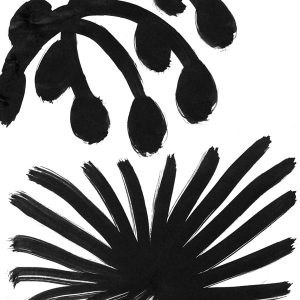
Auteur : Olivier Croufer, animateur au Centre Franco Basaglia
Résumé : En ville, dans les salons, chez soi, dans les salons de thé et les salons de coiffure, les interlocuteurs s’écoutent et se parlent. Mais dans un salon de santé mentale, l’écoute serait-elle différente ? Ce serait bien utile de le savoir pour importer l’un ou l’autre de ses aspects dans nos salons ordinaires.
Temps de lecture : 15 minutes
En ville, pour écouter, j’aime les salons. Aussi loin que je me souvienne, de la musique installait une atmosphère dans l’appartement de mon enfance. On fredonnait plus qu’on chantait. Cela résonnait en nous, ou pas, et nous l’exprimions. Le salon était aussi le lieu où nous écoutions des personnes, nous, la famille, et celles qui venaient nous rendre visite. En lisant Histoire de l’intime de Philippe Artières, je me rends compte que je n’ai jamais pris suffisamment la mesure de l’historicité de cette situation. Les salons naissent vraiment avec le 19e siècle, quand le domicile privé, inviolable, devient – en droit – une liberté du sujet, et quand, avec la révolution industrielle et le développement des villes, des maisons et des appartements sont construits où le salon vient occuper une place particulière entre la chambre, les couloirs et le dehors. « Ce nouvel agencement des intérieurs génère un mode de vie dans lequel le salon joue un rôle central. Il est le lieu d’intersection entre l’intime et le public, c’est là que l’on est chez soi, autant que l’on reçoit. En somme un espace frontière, un entre-deux.[1] »
Parmi d’autres lieux où l’écoute a, pour moi, une réalité, une classe, une salle de concert, un auditoire, la forêt, je retiens du salon cette « intersection entre l’intime et le public », cet « entre-deux », un lieu où le paravent est toujours présent pour délimiter l’intime des interlocuteurs à la frontière de ce qui peut se rendre public. À la suite du salon de la maison, on peut penser au « salon de thé » et au café où l’on s’installe avec une amie. Le « salon de coiffure » est singulier puisque les mains de la coiffeuse viennent toucher le corps et que les conversations s’échappent parfois du couple coiffeuse/coiffée pour atteindre le couple de la chaise voisine.
L’écoute, entre intime et ordre social
C’est Ludovic Medery qui m’a fait penser aux salons quand je me suis entretenu avec lui de son travail. Ses salons m’amenaient un problème auquel j’avais envie de réfléchir. Ludovic Medery travaille dans un service d’aide et de soins psychiatriques dans le milieu de vie. Ce lieu est aussi désigné sous l’appellation de service de santé mentale. Il est d’emblée venu à la question de l’écoute pour qualifier l’expérience de son travail. « Nous sommes une dizaine assis autour d’une grande table et j’écoute. » La grande table est celle d’une réunion d’équipe dans une pièce qui fut autrefois le salon d’une maison d’habitation. La cheminée de jadis est désormais camouflée derrière un placard de panneaux laqués blancs. Les murs sont saturés d’écritures et de listes, comme certains salons sont affublés d’un trop-plein de photos de famille. « Dans cette écoute, je suis silencieux. » Par la parole d’un.e collègue, il découvre une personne qui parvient ainsi jusqu’à lui. S’il reste en silence, c’est qu’il cherche à estimer ce que sa présence pourrait amener. « Je pourrais ne pas être capable d’apporter quelque chose à une personne. Je pourrais par exemple être dans une sorte d’agacement au point de ne pas être suffisamment apaisé pour écouter. » J’ai compris qu’il cherchait à œuvrer (apporter quelque chose à une personne), et que s’il y avait un bruit intérieur, celui-ci ne devait pas l’empêcher d’écouter. Et d’œuvrer. Présentement, ces deux verbes vont ensemble.
Jusqu’ici, rien de spécifique à un métier, il me semble que nous pouvons rencontrer cette expérience d’écoute dans nos salons habituels, à la maison, au café. Ludovic Medery dit d’ailleurs que ce « pouvoir de sentir ne lui a pas été donné par l’école, mais par l’expérience. C’est un savoir intuitif sur ce que je pourrais ou ne pourrais pas » et il est revenu à plusieurs reprises, dans notre conversation, sur l’humanité qu’il voulait dans une relation, lui ôtant ainsi une spécificité professionnelle. D’où ce mystère qui vaudrait la peine d’une réflexion collective : qu’il y ait eu un besoin pressant, à un moment de notre histoire sociale et culturelle, de lieux institués pour écouter un autre. Comme si nos salons ordinaires ne suffisaient plus. Dans une enquête documentée par le terrain, Des mots indicibles. Sociologie de lieux d’écoute, le sociologue Didier Fassin présente comment des lieux d’écoute institués se sont développés ces dernières décennies pour accueillir et écouter des personnes dont les problèmes relèvent de l’ordre public (délinquance, vagabondage, mendicité, etc.) et de la santé publique (toxicomanie, troubles psychiques, mal-être, etc.). « Une nouvelle économie morale de la compassion s’y est développée[2]. » On y écoute la souffrance du jeune victime de discrimination raciale, du travailleur licencié pour restructuration de son entreprise ou du demandeur d’asile débouté. Certes ces personnes souffrent, mais l’enquête de Didier Fassin nous invite à nous demander ce que « le langage de la souffrance et le gouvernement par l’écoute modifient de l’expérience des inégalités, tant individuelle (pour ceux qui les subissent) que collective (pour la société dans son ensemble)[3]. » Ces lieux d’écoute modifient la « manière de se présenter devant les autres dans un double registre pathétique et individuel : d’une part, les affects liés au malheur sont mis en avant ; d’autre part, les discours sont constitués sur le mode biographique. Il n’y a guère d’espace pour dire la violence des interactions dans lesquelles on se trouve pris (à l’école, dans son travail, avec la police, etc.) ou l’injustice des situations auxquelles on est confronté (en tant que jeune de milieu pauvre ou d’origine étrangère, en tant que demandeur d’emploi, etc.). Il n’y a pas beaucoup de place non plus pour une interprétation et des solutions d’ordre général (mettant précisément en cause l’ordre des choses), mais seulement pour des explications particulières renvoyant à des histoires singulières et à une capacité personnelle à faire face[4]. »
Formulées de manière à permettre un rebond, les conclusions de l’enquête de Didier Fassin pourraient pour le moins inviter les lieux d’écoute institués à mettre en œuvre des relances collectives et institutionnelles à partir des souffrances qu’ils accueillent. Mais c’est encore une autre relance à laquelle j’ai pu être sensible en m’entretenant avec Ludovic Medery : la reprise de nos salons d’écoute ordinaires, puisqu’ils sont aussi un lieu majeur du social.
J’ai perçu ce que serait la spécificité de ce lieu d’écoute quand il a raconté comment il parlait à des étudiants de son travail dans des auditoires et des classes dont il essayait, parfois en vain, de donner une atmosphère de salon. En s’efforçant de transmettre son expérience à ces étudiants, Ludovic Medery invoque des « balises » de « représentations ». « Une méthode par balise qui permet de naviguer comme dans ma pratique musicale », dit-il. Parmi ces balises, il cite en premier lieu une représentation de la « santé mentale », puis d’autres encore tels un « milieu de vie », un « territoire », un « diagnostic ». Là évidemment, l’écoute passe par l’institution dans laquelle elle se convoque. C’est parce que le salon d’écoute a lieu dans cette institution que des balises de représentations particulières sont appelées dans la parole. En ce qui concerne la « santé mentale », celle-ci est d’ailleurs plus qu’une représentation puisque s’y ajoute un horizon social. La santé mentale est une norme, un imaginaire social intensément inspirant pour des conduites à honorer. Ou mieux, des variations autour d’un imaginaire social, puisque Ludovic Medery présente aux étudiants plusieurs définitions de la santé mentale, plusieurs convocations de discours qui symbolisent cet imaginaire social. Ce ne sont pas uniquement des discours « constitués sur le mode biographique » pour reprendre les mots de Didier Fassin, mais des invitations à faire varier « l’ordre des choses », plus seulement « des explications particulières renvoyant à des histoires singulières et une capacité personnelle à faire face. ».
Les jeux d’écoute de l’arrangeur
Dans ces variations, Ludovic Medery demeure pour faire exister un jeu, une marge, une oscillation. Ces balises permettent d’enclencher des transmissions ». De l’un à l’autre. Se donner suffisamment de jeu devient la condition pour se mettre à l’œuvre ensemble. « J’essaie de ne pas mettre trop de colle dans mes représentations, de laisser place à une surprise et de me laisser transformer. » Comme si la partie, ou la partition, s’exécutait, s’interprétait au milieu de la rencontre, entre l’un et l’autre, ou de l’un à l’autre puisqu’on se laisse affecter. « Ces représentations sont une image que je me donne du fonctionnement de la personne par rapport aux difficultés qu’elle m’amène. C’est aussi une sensibilité à la vie qu’elle semble partager avec moi, ce qui peut émouvoir, ce qui peut faire rire. J’essaie de faire des liens, de créer une constellation, de manière à avoir une représentation toujours mouvante, vivante, de façon que ces liens soient multiples, multidirectionnels. » Ce va-et-vient installe une diffraction, des réfléchissements du monde. « Dans la représentation, je saisis un rapport aux mondes, ou des rapports aux mondes. Ceux de la personne, les miens, ceux des autres. La personne me confie ses représentations et je lui confie les miennes. Souvent ces confrontations sont très éclairantes. Parfois ça peut remuer les miennes, dans le bon sens, sans effet pénible, cela peut être drôle, ou léger. Parfois des divergences se marquent. »
Je me suis progressivement formé l’image d’un salon où les interlocuteurs mettaient à l’œuvre les imaginaires sociaux où s’enchâssaient leurs intimités. Je me suis longtemps demandé comment qualifier ces interlocuteurs. J’ai cherché une appellation qui permettrait d’atteindre une expérience plus commune que celle qui serait spécifique à un métier de la santé mentale ou de la psychiatrie. Je ne doute à aucun moment que Ludovic Medery exerce une écoute dont le savoir-faire s’étaye d’une expérience de la psychose par exemple. Sans cette singularisation spéciale de l’écoute, ce que ratent les écoutes plus ordinaires risque de ne jamais être entendu. Mais c’est précisément cette écoute, qui pour une part naît d’un métier et d’un secteur spécifique lié à la psychiatrie, qu’il est essentiel d’envisager étayée ailleurs, plus proche de nos expériences ordinaires, dans des salons qui ouvriraient des alternatives à une relégation vers des spécialistes. J’essaie d’envisager comment ne pas nous démunir, mais au contraire nous enrichir des formes d’écoute exercées par des spécialistes des souffrances existentielles.
J’ai finalement trouvé une proposition pour qualifier ces interlocuteurs d’un salon d’écoute chez Peter Szendy. Il est philosophe et musicologue, il est aussi professeur de littérature comparée, il donne des cours sur le passage de la littérature d’une langue à l’autre. Il aime les arrangeurs, par-dessus tout, dit-il. Les arrangeurs sont les musiciens qui tout au long de l’histoire de la musique ont arrangé une œuvre existante selon l’écoute qu’ils en avaient. Liszt qui crée une version pour piano des neuf symphonies de Beethoven, par exemple. Je pense que nous pouvons considérer comme une œuvre d’arrangeur les « reprises » qui parfois se démultiplient de l’une à l’autre. La vie en rose d’Édith Piaf, reprise par des centaines d’artistes, Louis Armstrong, Iggy Pop, Dalida, Patricia Kaas, Khaled…, mais aussi plein d’inconnues. « Il me semble que ce que les arrangeurs signent, c’est avant tout une écoute. Leur écoute d’une œuvre. Ce sont peut-être même les seuls auditeurs de l’histoire de la musique à écrire leurs écoutes, plutôt que les décrire (comme le font les critiques). Et c’est pourquoi je les aime, moi qui aime tellement écouter quelqu’un qui écoute. J’aime les entendre entendre[5]. » Avec les arrangeurs, la transmission opère par un droit à écrire son écoute. Si ce droit est possible, c’est que, d’une part, l’auteur-sujet produit l’œuvre comme « restant à faire[6] » et que, d’autre part, l’auditeur-sujet se constitue en faisant entendre ce que son écoute lui a fait entendre. « C’est là, je crois, la force propre à tout arrangement : nous entendons double. Dans cette écoute oscillante, bifide, dans cette écoute qui se laisse creuser par l’écart sans cesse traversé entre la version d’origine et sa déformation au miroir de l’orchestre, ce que j’entends, c’est en quelque sorte que l’originalité de l’original reçoit son lieu propre depuis sa mise à l’épreuve plastique.[7] » Il ne s’agit pas d’écraser une version par une autre, ou de remplacer une version par une autre qui serait meilleure ou plus vraie (bien que des jugements puissent se glisser dans l’écoute du passage d’une version à l’autre), mais d’entendre double. Là est l’horizon où tentent de nous mener les arrangeurs.
Quand Ludovic Medery glisse à ses étudiants des représentations de la santé mentale, il essaie que « les étudiants s’expriment sur leur rapport personnel à ces représentations. », qu’ils fassent entendre leur écoute de ce qui est à l’œuvre. Si je quitte un instant le registre musical, nous pourrions invoquer les traducteurs. C’est d’ailleurs l’invitation à laquelle nous conduit Peter Szendy. « Je l’ai dit, j’aime les arrangeurs ; et c’est sans doute pour les mêmes raisons que j’aime les traducteurs. J’ai toujours l’impression, en effet, de les lire en train de lire, de lire leur lecture d’une œuvre. Ils signent leur lecture comme les arrangeurs signent leur écoute. Et c’est pourquoi toute réflexion sur la lecture – sur ce que c’est que lire un texte – devrait en passer par la question de la traduction.[8] » Le philosophe Walter Benjamin dans un texte célèbre[9] sur la traduction nous rappelle que ce n’est pas l’adresse ou la maladresse des traducteurs qui fait que l’original se déforme, mais c’est plutôt que la langue vit. L’original est plastique parce qu’il est fait de langue et la traduction nous révèle cette instabilité de l’original. Le « visé » – c’est-à-dire, si l’on veut, le « sens » ou l’« esprit » – n’est pas déjà là dans l’original : il serait plutôt quelque part à l’horizon, quand il passe dans une autre langue, quand il survit dans une autre version. Ludovic Medery dans son auditoire ou sa classe d’étudiants parle de « retours de transmissions » à partir des « balises de représentations ». « Ce retour de transmission est fondamental pour la rencontre d’un être humain. Une rencontre essaie d’ouvrir plus de retours. (…) J’essaie d’ouvrir les retours pour ne pas apparaître dans une opération de formatage, mais d’émancipations. » Ce n’est pas la reprise, par ailleurs illusoire, de la norme qui importe, mais sa survie dans une traduction qui révèle son instabilité. « Dans ces échanges, je ne donne pas de recettes, mais j’essaie d’installer une réflexion sur la relation, comment être dans une rencontre humaine. J’essaie toujours de déjouer la réponse et de permettre une construction. Ce n’est pas facile car beaucoup d’étudiants se focalisent sur l’aboutissement et sur la réussite de l’aboutissement. »
Nous avons peut-être avec le salon des arrangeurs un dispositif appropriable et stimulant. Les arrangeurs installent au milieu du salon non pas une version, mais une œuvre dont ils font entendre leurs écoutes. L’arrangeur ne peut faire écouter son écoute qu’en « raturant[10] » l’œuvre à entendre ou en l’immisçant dans une constellation sonore nouvelle. Cela n’est possible que pour autant que le premier interlocuteur ait laissé l’œuvre « en souffrance », que le sens de l’original ait été laissé « en attente » de la complémentarité d’une autre écoute, d’une autre langue, d’un arrangeur. L’un des bienfaits d’un arrangeur est de déjouer la flamboyance de l’univocité. Les arrangeurs tirent leur joie des variations ou même des dissonances qu’ils parviennent à œuvrer ensemble. Dans le salon des arrangeurs, l’émancipation se fait à l’aune d’une rature, d’un écart qui laisse entendre une différence dans son écoute. En se rappelant que la norme de santé mentale prétend donner sens à la vie d’une prophétie du bien-être, laisser en souffrance l’univocité de cet éblouissement est certainement une occasion de s’en sortir. Mieux vaut laisser entendre ses écarts intimes à la norme, dirait l’arrangeur dans son salon, dans l’entre-deux de l’intime et du public.
Notes
[1] Artière, Philippe. Histoire de l’intime, CNRS éditions, 2022, p.19.
[2] Fassin, Didier. Des maux indicibles. Sociologie des lieux d’écoute, La Découverte, 2004, p. 316.
[3] Fassin, Didier. Op. cit., p. 312.
[4] Ibid, p. 315.
[5] Szendy, Peter. Ecoute. Une histoire de nos oreilles. Minuit, 2001, p. 53
[6] Ibid, p. 24.
[7] Ibid, p. 54.
[8] Ibid, p. 68.
[9] Benjamin, Walter. La tâche du traducteur, in Œuvre. Petite biblio Payot, 2022.
[10] Szendy, op. cit., p. 25.